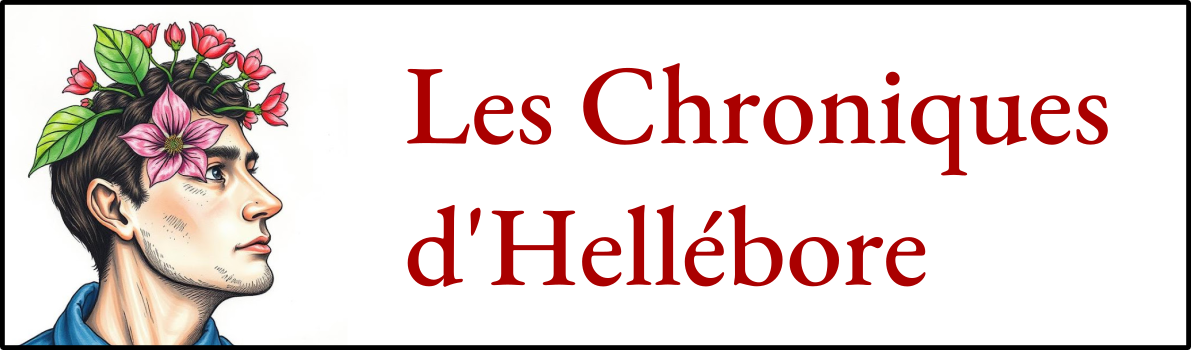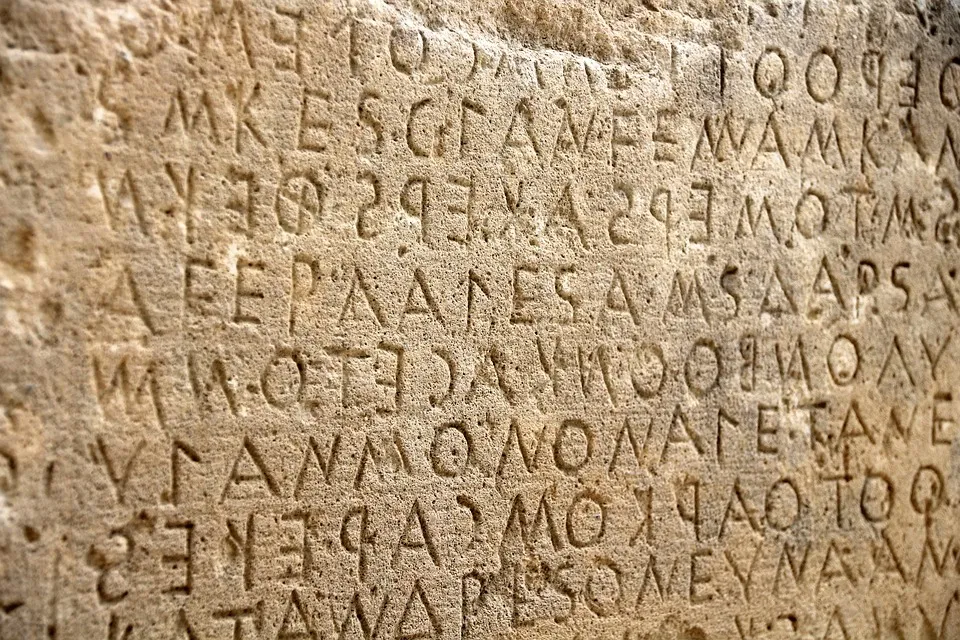Variabilité, cyclicité et requis d'invariance


Le principe indépassable de l’éphémérité des formes et notre capacité à observer ces dernières au sein de notre expérience du monde impliquent censément que nous ne faisons qu’expérimenter des variations de ce même monde. En effet, ma capacité à identifier les éléments d’un paysage, par exemple, sa texture, ses couleurs, ses mouvements, dépend directement des différences entre ces éléments : texture grenue ou lisse, vert ou marron, immobile ou mobile. En l’absence de différence, de variation, je ne pourrais pas les identifier. Comme on ne peut prendre conscience de la lumière qu’à la condition de son absence (l’obscurité), la couleur verte qu’à la condition de son absence (les autres couleurs, non-vertes), on ne peut certifier de l’existence d’une forme, d’un phénomène, que si nous avons par ailleurs pu expérimenter son inexistence.
Ce qui signifie, entre autres, que nous pouvons théoriquement être soumis à une infinité de phénomènes parfaitement réguliers et permanents que nous sommes incapables de reconnaître, simplement parce que nous n’expérimentons pas leur absence.
Cette nécessite de variabilité des formes au sein de notre expérience tend à engendrer des phénomènes répétitifs qui ne sont cependant jamais parfaitement réguliers. En effet, la propriété manifestante et temporalisante du principe matriciel, jointe au caractère fractal de la réalité, nous amène au final à non seulement observer les phénomènes sous formes de variations mais aussi sous formes de cycles : cycles de début et de fin, de naissance et de mort, de toutes les choses, à toutes les échelles et y compris au sein même des composants de ces choses que nous observons.
Nous pouvons par exemple observer les cycles des saisons, les cycles hormonaux, les cycles vibratoires (atome, cellule, cœur, astre, galaxie), les cycles circadiens, etc.
Cela peut même aller plus loin, car il est possible de considérer l’observation de phénomènes comme une forme de variation en soi. En cela, chaque inclination observée du monde sous forme de phénomènes existants suppose la naissance et la mort de sous-espaces-temps miroirs dont la trajectoire est répercutée simultanément à toutes les échelles. Lorsque je lance mon caillou dans la mare, je ne peux observer et comprendre ce phénomène qu’à la condition que cet acte soit en lui-même la variation de quelque chose. Au-delà des variations multiples dues à l’action et les forces qu’elle implique, il est possible de considérer que l’acte en lui-même émerge d’une indétermination qui se détermine (vais-je ou non lancer mon caillou ?). Le fait que la réalité emprunte un chemin déterminé plutôt qu’un autre tend ici à suggérer qu’un phénomène équivalent inverse doit exister pour que ce chemin puisse effectivement être emprunté.
Cela signifierait que toute existence ne peut apparaître qu'à la condition de son inexistence équivalente par ailleurs, qu'à la condition de sa nature variable, que nous présentions juste avant. Cette condition suppose que tous les objets concevables et observables sont en réalité des espaces cycliques dont le bilan des forces sera toujours égal à zéro.
Ainsi, la réalité fractale infinie ne peut exister sans le préalable du néant. On ne peut concevoir de tout sans rien ou de plein sans vide. On ne peut logiquement admettre l'existence de quoi que ce soit sans la présenter sous la forme d'une infinité de phénomènes qui ne peuvent exister sans une réplique exacte, inverse et simultanée de leur inexistence. Cependant, le néant ne pouvant, par définition, rien engendrer, le simple fait d'existence signifie que toute forme d’absence est elle-même irrémédiablement intriquée au principe d'existence. Une dualité fondamentale jumelle des principes essentiel et matriciel, sans en être équivalente bien entendu.
Cette possibilité n’est pas illusoire car les recherches actuelles en physique, et notamment le modèle cosmologique bi-métrique dont l’une des formulations les plus abouties est celle du modèle Janus du chercheur français Jean-Pierre Petit, s’aventurent régulièrement du côté de modèles symétriques et équilibrés dont l’évolution dynamique n’est possible qu’à la condition de son inverse par ailleurs.
Cela peut cependant déboucher sur un nouvelle découverte fractale. En effet, si le fait d’existence tangible forme un système qui ne peut se manifester et évoluer qu’à la condition de son reflet inverse, qu’en est-il du système réalité/reflet lui-même ? Est-il, lui aussi, soumis aux mêmes impératifs et possède-t-il donc son propre reflet quelque part ? On voit bien qu’une telle question ne peut se résoudre que de façon fractale car chaque système établi engendre à son tour la même question. Il est d’ailleurs tout à fait prévisible que nous y observions là aussi des phénomènes cycliques de naissances et de morts.
À ce propos, la consommation matricielle des essences se présentera toujours selon deux dynamiques : une première étape où prédomine la manifestation d'une essence et une seconde étape où prédomine sa destruction.
Puisqu'il nous est possible d'observer sans ambiguïté certaines choses à des degrés divers selon les personnes, il est important de préciser ici que ces variations observées dépendent directement de la propre variation de l'observateur (qui n'est pas étranger au principe de forme éphémère), c'est-à-dire sa durabilité, sa consistance ou pour mieux dire son propre contexte. Sans correspondance croisée de ces variations, l'observateur n'observerait rien, rien n'aurait de forme car lui-même n'aurait pas de stabilité temporelle suffisante pour déterminer une continuité d'existence des objets.
C'est en fait l'invariance de l'observateur à l'intérieur même de son contexte qui lui permet d'observer les variations de la réalité. Car on ne peut observer de variations qu'à partir d'au moins un élément stable (comme la mémoire, par exemple, qui participe au sentiment d’identité mais qui comporte aussi ses propres variations et parmi elles quelquefois des erreurs d’enregistrement de faits).
Cependant, puisque l'observateur lui-même possède ses propres variations intrinsèques, cela signifie que son observation cesse d'être continue dès lors que l'ensemble de son identité a varié, dès lors qu'il n'existe plus aucune continuité entre le moment qui a débuté l'observation et le moment présent. Cela indique à la fois le début possible d'une nouvelle observation mais surtout un changement d'état de l'observateur : une mort, tout simplement, peu importe à quoi elle se rapporte. À ce titre, la notion d'observation peut concerner une lecture claire et précise des objets ou bien un sentiment diffus de contact, cela n’a pas d’importance. Il existe bien entendu des disparités sensibles d'observation parmi les êtres.
Néanmoins, puisque la réalité est construite de façon fractale, il ne faudrait pas concevoir la notion de mort comme une fin totale, sans quoi elle signifierait la fin de la réalité et cela n'est pas possible, comme nous l'avons vu précédemment. Ce qu'il convient plutôt de comprendre à travers le phénomène de la mort est la fin d'un contexte, borné dans le temps et l'espace, dont l'expression éphémère a été l'une des formes possibles créées par l'action conjointe du principe essentiel et du principe matriciel.
Il est donc certain qu'on ne meurt jamais tout à fait, comme on ne naît jamais tout à fait, mais que nous expérimentons des contextes qui ne durent pas et donc des formes d'observation qui sont variables, à l'infini. Cependant, puisque notre propre identification de nous-mêmes dépend de notre observation, il ne faudrait pas non plus imaginer la mort comme un changement d'état après lequel nous garderions la même perception, le même intellect, les mêmes repères, les mêmes valeurs ou les mêmes idées qu'avant de le vivre, cela n'est absolument pas garanti et même très peu probable compte tenu de ce que l'on expérimente d'ores et déjà dans notre vie lorsque nous dormons.