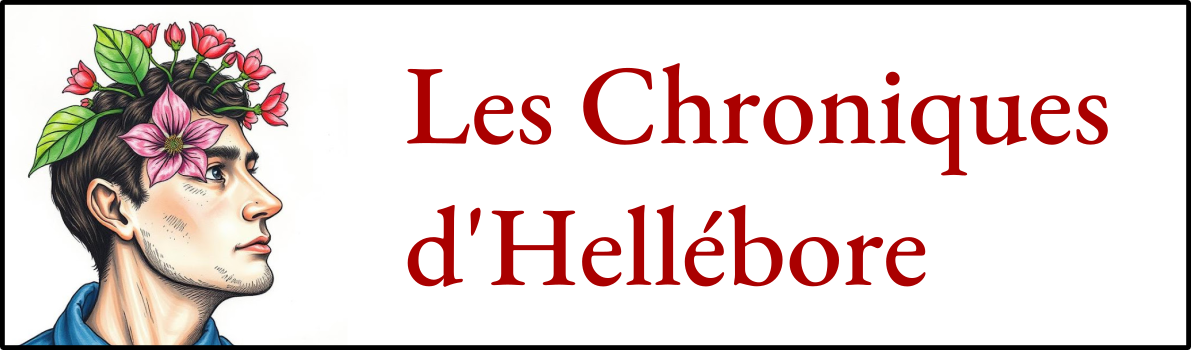Qu'est-ce qu'un individu ?


Dans certains de mes articles précédents, j’ai abordé la question de l’individualité sans l’expliciter outre mesure. Je souhaite ici donner davantage d’informations à ce sujet.
Posons tout d’abord l’« être ». L’être est une notion que j’emploie de façon extensive. Cela signifie que, par la nécessité de la coexistence, l’être est plus ou moins en rapport avec la totalité de ce qu’il pourra expérimenter, ce qui équivaut dans la pratique, pour l’être en question, à l’univers dans son ensemble (on ne saurait considérer de réalité plus vaste que ce que l’on peut considérer…).
L’être peut être n’importe quoi, il peut s’agir d’un individu ou d’un ensemble d’individus ou bien d’une partie seulement d’un individu, ou autre chose. Ici, c’est notre esprit qui sectionne la réalité de façon à y circonscrire un élément significatif.
Si je parle de moi-même en temps qu’être, je parle de mon individualité mais aussi de toutes mes dimensions supra et infra-individuelles.
Il ne faut pas cependant considérer ici que toutes ces dimensions se valent pour l’être concerné (ici, moi-même). Le fait que je puisse observer à la télévision la mort d’un insecte à l’autre bout de la planète témoigne que cet insecte m’est à la fois familier et étranger (principe de coexistence) mais ne signifie pas que sa mort aura le même impact pour moi que la mort de l’un de mes proches, par exemple. Si mon être possède des liens avec le cosmos dans sa totalité, ceux-là ne sont pas tous équivalents. Que je me casse une jambe me concernera de plus près que si c’est mon voisin qui se casse une jambe.
Il y a donc une caractéristique variable d’intimité entre moi-même et le reste du réel.
Cette variabilité explique pourquoi mon individualité m’est particulièrement intime, à la différence de celles que je ne connais pas du tout.
Cela signifie que ce qui forme mon être est une polarisation spécifique de tous les éléments du cosmos et c’est cette polarisation qui manifeste précisément qui je suis, selon un gradient du plus universel (maximalité) au plus particulier (minimalité).
Et il en est de même pour toutes les formes de considération que nous pourrions produire.
Dans la pratique, cela met en évidence des concepts saillants. En tant qu’individu, je suis manifestement :
un élément du cosmos (qui peut être défini par son identité, sa puissance et son expression) soumis à l’espace et au temps
un corps (un ensemble organique cohérent)
un esprit (un ensemble psychique cohérent)
un ego (une expérience de l’individualité)
un héritage et une mémoire (génétique, culturelle, ethnique, familiale, personnelle, etc.)
une âme (une forme supérieure d’égo sur laquelle je reviendrai)
un potentiel
un être sensible et interprétateur
un cycle de vie (de la naissance à la mort)
un animal social
un humain
un homme
un créateur
un consommateur
un penseur
un écrivain
une manifestation éphémère de principes hors du temps
une expression de Dieu
etc.
Ici, le terme « etc. » suggère une infinité de définitions possibles que je serais bien incapable d’énumérer exhaustivement. Cependant, cela n’est pas très utile car, justement, c’est le degré d’intimité avec un concept et la façon dont ce dernier va nous aider à comprendre le monde et nous comprendre nous-mêmes avec lui qui vont donner du sens à une définition plutôt qu’une autre. L’évaluation de la pertinence d’une information se fera par ailleurs toujours en fonction d’un contexte.
Le fait de dire que je suis une « expression de Dieu » est par exemple très peu signifiant, puisque toutes les choses sont des expressions de Dieu et que cela reste vrai quel que soit le contexte. Cela peut néanmoins trouver son sens dans une discussion sur la nature de Dieu, pourquoi pas.
Dire que je suis un homme est déjà une définition plus précise et qui sera probablement utile dans un plus grand nombre de contextes, mais c’est aussi une définition plus incomplète car qui je suis ne se résume pas au fait que je sois un homme.
De façon générale, plus nous précisons nos définitions, plus cela signifie en fait que nous précisons nos contextes de pensée. Cela n’est pas un problème en soi mais j’estime personnellement que nous gagnerions à nous améliorer quant à l’expression des contextes que nous abordons car, dans bien des cas, notre imprécision dans ce domaine nuit à la pertinence de nos analyses et à la qualité de nos communications avec nos semblables.
La même logique doit prévaloir pour toutes les tentatives d’explication du monde car, dans le cas contraire, nous n’aurions de cesse de nous abîmer dans des explications interminables ou abstraites dont la pertinence sera en définitive très relative, sinon parfois inexistante. Ce phénomène est d’ailleurs très courant en philosophie où le pinaillage est fréquent et concerne le plus souvent des contextes très précis, indéfinis, ou bien des contextes complètement artificiels créés par le philosophe lui-même pour illustrer une pensée sans grand intérêt, et qui n’apporte en fin de compte pas grand-chose dans notre compréhension de la réalité.
À ce propos, ce qui va nous permettre de déterminer la pertinence dans l’usage des contextes sera justement notre degré d’intimité avec ceux-ci, degré d’intimité perçu à travers le prisme de notre propre expérience de la réalité.
En résumé, je propose ainsi de comprendre notre existence comme la rencontre focalisée de différents principes du monde qui, une fois combinés, produisent une occurrence unique d’expérience. Cette occurrence est, notamment, individuelle, mais pas seulement. Le corollaire de cette définition est par ailleurs qu’il n’est possible de comparer les individualités que sur certains points seulement (les points dont l’intimité avec les sujets comparés est équivalente) car, au-delà de ces points, l’unicité prévaut et donc la comparaison est vaine.
Aussi, les déterminismes cités plus haut, qui font qu’un individu sera ainsi et non différemment, permettent de comprendre les origines des personnalités et notamment les teneurs de nos dimensions matricielles et essentielles.