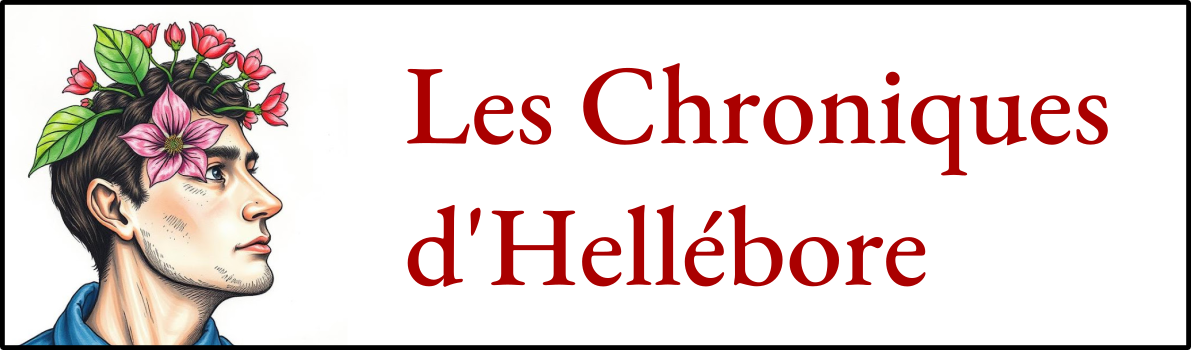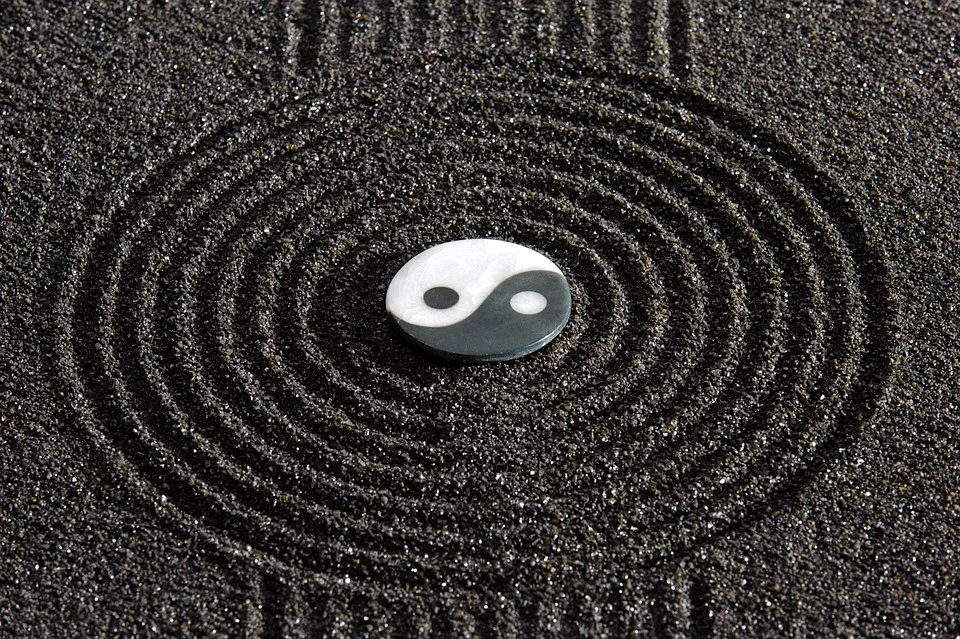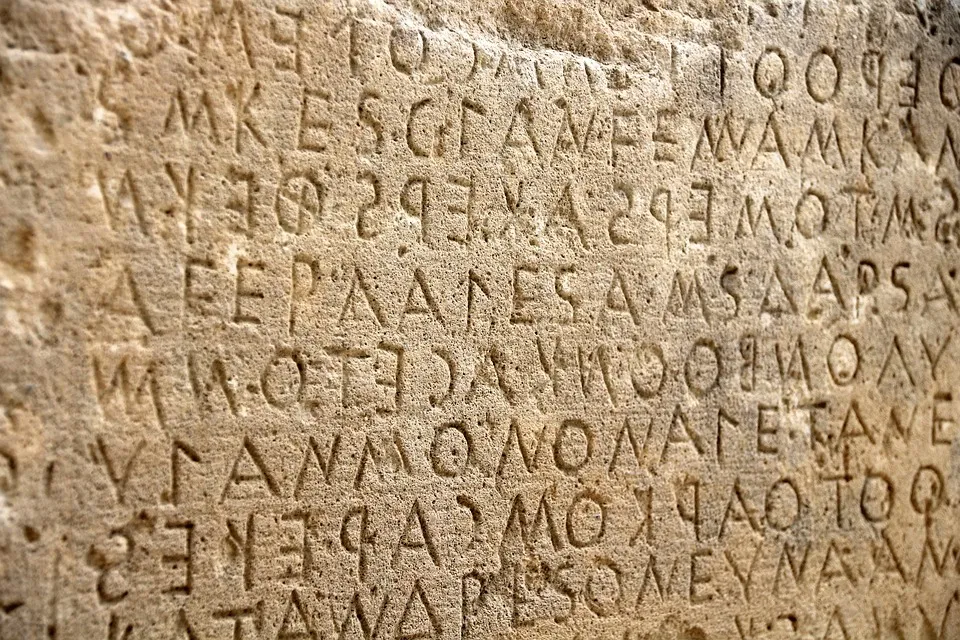Qu'est-ce que l'égo ?


Prenons le temps maintenant de définir ce qu’est véritablement l’égo.
L’égo, c’est l’expérience de soi-même en tant qu’individualité. J’emploie ici à dessein le terme d’« expérience » pour le différencier de celui de la conscience. En effet, si la conscience fait intervenir le fait d’être parfaitement au courant de quelque chose (« J’ai conscience de mes limites. »), elle ne suffit pas à expliquer les fonctionnements égotiques qui comportent également une dimension inconsciente, et pas des moindres !
Le terme d’expérience est plus vaste car, dans bien des cas, même si nous ignorons ce que nous vivons, il n’en demeure pas moins que nous le vivons bel et bien. On peut prendre pour exemple le fait d’être soumis en permanence à des rayonnements cosmiques sans que nous le sachions (la plupart du temps et pour la plupart d’entre nous).
L’égo est donc le fait d’être dans le monde de façon particulière, il nous individualise face à l’univers. Et il est associé à la perception et au sentiment que nous avons de nous-mêmes à travers cette expérience.
Cependant, l’égo n’est pas nous-mêmes, il n’est qu’une dimension de nous-mêmes. En effet, rappelez-vous, les choses ne sont pas des atomes disjoints et inconnus les uns des autres mais un ensemble à la fois familier et étranger qui témoigne de dimensions communes. En cela, notre égo n’est qu’une part de nous-mêmes, car nous sommes aussi à la fois la résultante et les manifestateurs de dimensions plus vastes et non strictement individuelles.
Une autre manière de le dire est de considérer “nous-mêmes” comme une dimension partielle de notre expérience, cela revient à la même chose mais je trouve cette approche un tantinet plus complexe à manier et je privilégierai donc la première, à savoir que le soi est la manifestation conjointe de dimensions multiples, des plus universelles aux plus particulières et que l’égo n’en est que l’une d’entre elles, celle qui concerne notre expérience d’individualité et la perception et le sentiment qui vont avec.
L’égo concerne donc aussi toutes les dynamiques et sentiments que nous éprouvons en lien avec cette individualité, à commencer par l’instinct de survie individuel, qui est très puissant et que l’on observe aussi aisément dans la nature sauvage.
Les doctrines spirituelles qui considèrent l’égo comme un fardeau et même parfois carrément comme une maladie sont donc nécessairement mortifères et ne valorisent que les dimensions supra-égotiques des humains, à savoir des dimensions plus universelles que l’individualité. Ces dimensions, naturellement limitées dans leur expression par les sentiments égotiques de tout un chacun, ne peuvent censément se manifester en plein qu’à la condition de la disparition des égos, ce qui, sur Terre, consiste le plus probablement en l’annihilation de la vie elle-même.
À comprendre également que cette chasse à la volonté personnelle, en quelque sorte, est aussi une négation de Dieu, puisque celui-ci possède au moins sans aucun doute la volonté de créer. Dieu est en fait l’Égo des égos et vouloir s’en approcher en niant cette réalité me paraît fondamentalement contradictoire. L’annihilation de l’égo est certainement destructeur mais n’apparaît pas pour autant comme une quelconque démarche de sagesse pour comprendre la nature de Dieu, tout au mieux un chemin spirituel parmi d’autres.
À l’inverse, la tendance, courante à notre époque, d’hyper-égotisation tend à nier les dimensions supra-individuelles de l’être humain et se coupe en cela de bien des aspects du soi, à commencer par le sentiment de communion avec plus grand que soi-même : son conjoint, sa famille, sa communauté, la nature, l’univers, Dieu, etc.
Il n’est pas question ici de considérer comme bien ou mal l’une ou l’autre des approches mais de montrer que leur application engendre des conséquences inévitables car consubstantielles.
La définition de l’égo étant posée, voyons maintenant la forme qu’il prend selon qu’il s’agisse d’un égo masculin ou d’un égo féminin.
Dans mon article précédent, j’ai pris le temps d’expliquer de façon générale les dynamiques naturelles des hommes et des femmes. Les hommes cherchent à projeter en dehors d’eux-mêmes leurs essences intérieures tandis que tous les humains cherchent à assouvir leurs appétits, un besoin plus fort chez les femmes que chez les hommes. Dans le premier cas, l’élément inspirant est l’essence, qui peut se traduire en concept, c’est une idée pure qui sous-tend la manifestation des formes. Dans le deuxième cas, c’est la forme qui inspire, soit par mémoire, soit par sollicitation directe (comme lorsque l’on a envie de manger ce qui se trouve dans la vitrine d’une pâtisserie).
Ces dynamiques complémentaires, associées à un égo, c’est-à-dire à une individualité, produisent des mécanismes typiques et très différents entre les hommes et les femmes.
Dans le cas de l’homme, par sa dimension exclusive Y que ne possèdent pas les femmes, celui-ci éprouve à la fois une volonté de se projeter dans l’univers tout en sachant qu’il n’y est qu’un individu parmi d’autres, et notamment un homme parmi d’autres hommes. Cela le conduit à développer une dynamique personnelle en partie centrifuge, c’est-à-dire qu’il va œuvrer pour lui-même et les essences qui l’habitent et se projeter vers l’extérieur. Il se met ainsi en compétition avec les autres hommes qu’il estime porteurs d’essences antagonistes aux siennes et forme des alliances avec les hommes qu’il estime porteurs des mêmes essences que lui ou au moins d’essences compatibles avec les siennes.
En ce qui concerne son rapport à la dimension matricielle des êtres humains (les femmes en premier lieu mais aussi les hommes), l’homme cherchera à rencontrer celle qui aura de l’appétit pour les essences qu’il cherche à manifester car ce sont justement ces matrices compatibles qui vont lui permettre de le faire en donnant un sens concret à ses projets et en y participant souvent directement (comme une femme qui peut être à la fois pour un homme une raison d’engagement mais aussi une alliée objective et active).
En fonction de sa perception de lui-même et notamment de la place qu’il accorde à son égo, l’homme va plus ou moins être capable de se sacrifier pour ses projets (ou pour des personnes qu’il reconnaît comme porteuses de projets similaires aux siens). En effet, plus il valorise ses essences sans faire grand cas de lui-même en tant qu’individu, plus il va œuvrer à des projets où il n’est pas l’élément central mais simplement un acteur. Ce type d’homme est ainsi assez peu orgueilleux et met pour ainsi dire son ego au service de projets qui lui sont généralement supérieurs en termes d’universalité. Cela peut le conduire à des imprudences et à une négligence de lui-même en tant qu’être de chair. C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle les hommes vivent moins longtemps que les femmes. À l’extrême, de tels hommes condamnent rapidement leur existence.
En outre, plus ce type d’hommes appliquent leur masculinité à l’universel, plus ils se mettent à ressembler au principe essentiel, que l’on peut aussi appeler Dieu le Père. Ils informent le monde de leurs essences intérieures et œuvrent à leur manifestation concrète et tendent à considérer comme pertinentes toutes les essences du monde.
En revanche, un homme qui considère son égo comme un équivalent de son existence aura tendance à l’orgueil et à l’égoïsme. Il souhaitera par exemple apposer sa marque sur ses découvertes et ses réalisations, il appréciera se mettre en avant et faire passer sa propre personne avant tout le reste. Ce type d’homme tend par ailleurs à être en compétition avec tous les hommes, qu’il identifie comme des rivaux car représentant des individualités différentes de la sienne et cherchera à les détruire ou les dominer. Seules les limites de la réalité pourront l’inciter à envisager certaines alliances de circonstances qui ne représentent pour lui qu’un moyen d’arriver à une fin et non de véritables amitiés.
Son rapport à la féminité est aussi très unilatéral puisque ce type d’hommes la considère comme une matrice qui ne peut avoir de valeur que par la manifestation de qui ils sont. En cela, le fait que certaines femmes puissent avoir du désir pour d’autres masculinités qu’eux sera très mal vécu (jalousie extrême).
Par ailleurs, puisque les énergies de tels hommes ne sont consacrées qu’à eux-mêmes, elles ne s’appliqueront que sur une essence très réduite (l’idée qu’ils ont d’eux-mêmes), représentée par une seule occurrence (leur existence mortelle) mais qu’ils souhaiteront diffuser dans l’univers entier. Cela les conduit irrémédiablement au sentiment d’impuissance car seul Dieu le Père possède la puissance nécessaire pour féconder totalement la Déesse Mère. Les hommes incarnés, bien que possédant des puissances très variables, n’en restent pas moins des hommes.
Dans tous les cas, s’il y a une raréfaction des matrices disponibles (en particulier les femmes mais cela concerne tous les types de matrices possibles), la compétition entre les hommes s’intensifie et pas seulement pour des raisons d’orgueil, contrairement à ce que beaucoup pensent. En effet, même un homme peu orgueilleux qui souhaite manifester ses essences intérieures sera compétitif s’il entrevoit un risque de ne pas y parvenir du fait d’un déficit matriciel. Son agressivité en ce cas n’a pas pour but de le mettre en avant en tant qu’individu mais en tant que porteur d’essences qu’il valorise plus que tout. Ce phénomène est notamment assez présent dans le domaine politique où toutes les compétitions ne sont pas nécessairement le fruit de l’affrontement d’hommes orgueilleux mais parfois tout simplement le fruit de l’affrontement d’hommes passionnés.
Seuls les hommes très peu puissants n’entrent pas en compétition dans un contexte de raréfaction des matrices. Cette faible puissance peut être naturelle mais aussi provenir d’une psychologie dépressive.
En ce qui concerne la nature matricielle, totale chez les femmes et partielle chez les hommes, l’association de l’instinct consommatoire et de l’égo produit une dynamique personnelle centripète.
La femme a pour fonctionnement souverain des appétits qu’elle assouvira directement si elle le peut ou qui l’amèneront à déployer des efforts pour parvenir à les assouvir. Ces appétits se développent par sa connaissance de son environnement mais ne peuvent émerger d’elle-même. En cela, la femme a besoin d’être inspirée par des éléments extérieurs et notamment des hommes. Sa nature matricielle permet ensuite à ces derniers de manifester leurs essences, y compris sans qu’ils en soient informés (c’est le cas des penseurs ou des artistes influents par exemple, qui inspirent des milliers des personnes qu’ils ne connaissent pas et ne connaîtront jamais).
À la différence des hommes, qu’une dimension essentielle vient équilibrer, cette nature centripète de convoitise est systématiquement tournée vers la femme en tant qu’individu. En effet, en l’absence de dimension essentielle, les femmes ont recours aux choses manifestées pour développer leurs goûts et la plus prégnante des choses manifestées dans la vie des femmes est elles-mêmes.
En cela, la femme est toujours narcissique. Elle se pense systématiquement comme le centre de l’univers et voit les hommes comme des pourvoyeurs de sécurité, de confort, de plaisir et d’amusement. Les autres femmes sont pour elles tout au mieux des alliées mais jamais véritablement des amies : leur centre d’attention ne coïncide pas. Là où les hommes peuvent œuvrer au même projet, à la même essence, les femmes n’œuvrent toujours que pour consommer et donc toujours pour leur propre individualité.
Mais il faut préciser ici ce que l’on entend par là car, en toute sincérité d’observation, les femmes n’ont pas plus notion des essences que d’elles-mêmes (qui est au demeurant un concept en soi et leur est donc inaccessible).
Ce qu’elles identifient comme elles-mêmes n’est que leur instinct de consommation et si celui-ci peut être varié et changeant, il n’est jamais équivalent à leur personne dans son entièreté. C’est pour cette raison que les femmes se mettent régulièrement dans des situations difficiles alors même qu’elles souhaitaient assouvir un désir. C’est pour cette raison que beaucoup d’hommes voient souvent en les femmes des enfants frustrés, rattrapés par la réalité. C’est aussi pour cette raison que de nombreuses femmes n’ont aucune notion de la réalité au-delà de l’objet de leur désir. Si l’objet en question doit être atteint au prix d’efforts et d’attentes qui durent vingt ans, elles formuleront en elles-mêmes ces vingt années d’atermoiement mais si ce désir est consommable à la minute, elles le consommeront à la minute, dans les deux cas, sans anticiper les conséquences que cela va produire.
La seule chose qui peut retenir une femme dans l’assouvissement d’un désir qui lui paraît accessible, c’est si celui-ci compromet l’assouvissement d’un désir accessible encore plus grand. Pour le reste, ce sont les hommes qui posent des limites à l’assouvissement des désirs des femmes car ces derniers viennent régulièrement contrecarrer leurs projets. J’y reviendrai dans d’autres articles.
Attention cependant, il ne faudrait pas penser ce narcissisme féminin comme nécessairement contraint à des notions purement matérielles. Il est tout à fait possible que celui-ci s’exprime à propos de notions non matérielles comme l’âme. Le critère déterminant du narcissisme (comme de l’égoïsme) est la notion d’individualisation des considérations.
À savoir que ce type de dynamique égocentrée tend à deux choses :
elle produit de la frustration chez les femmes lorsque ces dernières observent des objets de désir auxquels elles ne peuvent accéder et dans un monde comme le nôtre où les objets de désir sont innombrables, elle tend à générer chez les femmes de nombreuses crises (hystéries, dépressions, névroses et psychoses)
elle empêche toute forme de phénomène social autre que centré autour de la femme, de sorte que tout projet collectif, demandant censément un sacrifice d’une partie des désirs matriciels, s’y refusant tend à ressembler à un culte servile de l’être féminin
En cas de raréfaction des porteurs d’essences (des hommes, principalement), la compétition entre les femmes s’accentue. De la même façon que pour les hommes, les femmes qui ne participent pas à la compétition dans un tel contexte sont généralement de très faible puissance et pour certaines d’entre elles, dépressives. Je reviendrai sur les sujets de la dépression et du suicide dans un article dédié.
J’ai décrit ici l’expression de la nature matricielle des femmes, qui est totale. Cette description vaut aussi pour la dimension matricielle des hommes. Cependant, puisque ces derniers disposent également d’une dimension essentielle, ils n’exprimeront pas de dynamique égocentrique aussi prononcée que les femmes. Là où la dynamique centripète des femmes est univoque, celle des hommes est bivoque, c’est-à-dire à la fois centripète et centrifuge et ce, dans les proportions correspondant à celles dont ils disposent. En effet, certains hommes sont plus essentiels ou matriciels que d’autres. Néanmoins, il n’existe pas d’homme dépourvu de dimension essentielle, sinon, il aurait tout simplement été une femme.
Nous pouvons par ailleurs remarquer à partir de ce qui vient d’être expliqué qu’une égotisation forte des personnes (égoïsme masculin et narcissisme de la dimension matricielle des femmes et des hommes) contribue à produire une société de violence compétitive élevée où les valeurs supra-individuelles comme le respect, la vérité, la liberté ou la beauté tendent à disparaître.