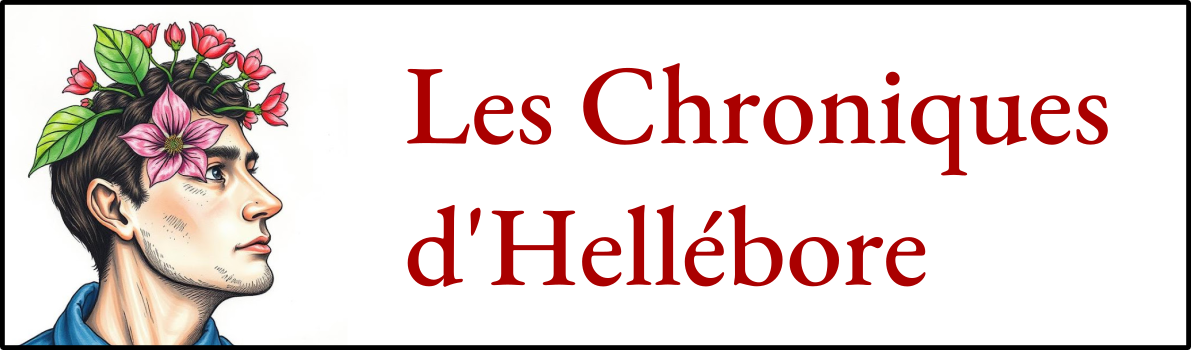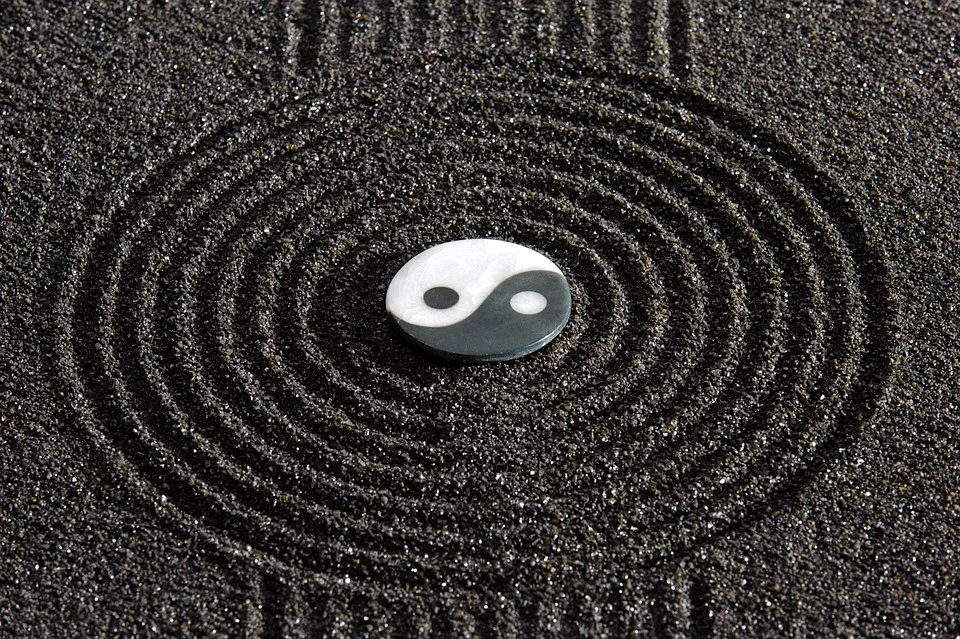Principes de coexistence, de relation et limites de l'expérience


Allons un peu plus loin dans la définition du phénomène d’expérience. J’ai dit dans mon article précédent que ce dernier était composé d’une dimension réceptive (sensibilité) et d’une dimension émettrice (influence). Ce phénomène implique une nouvelle dualité que nous allons voir maintenant.
Je reprends mon caillou.
Le fait que je puisse tenir ce caillou dans ma main pour le lancer dans une mare et en perturber ainsi la surface suppose deux choses indispensables et indissociables :
le caillou et moi-même faisons partie de la même réalité
je ne suis pas ce caillou
Le fait que je puisse influencer la caillou et le fait qu’il puisse être influencé par moi nécessite en effet que je partage avec le caillou une nature commune, fusse-t-elle infinitésimale. En l’absence d’une nature commune, le caillou ne ferait pas partie de ma réalité.
Cependant, j’ai également besoin d’une nature non-commune à ce caillou car, dans le cas contraire, je serais moi-même ce caillou et je ne pourrais pas l’observer comme quelque chose d’extérieur à moi-même.
Je propose d’appeler ce principe de base le principe de coexistence, qui ne peut être expérimenté que par la capacité de distinguer de soi-même un objet qui est extérieur.
Ce principe de coexistence implique un autre principe inévitable : celui de la relation. En effet, si toutes les choses que je peux observer et expérimenter du monde sont en relation avec moi-même alors elles sont également en relation les unes avec les autres, ne serait-ce que par mon intermédiaire.
Si je devais résumer cette idée de la façon la plus triviale qui soit je dirais : tout est lié !
Et j’aurais raison.
Il est en outre impossible de définitivement trancher sur la question des limites des êtres observants qui ne sont pas nous-mêmes, car nous ne pouvons savoir avec certitude ce qu'il en retourne. Lorsque j'observe le caillou, ce dernier est-il à même de m'observer ?
Dans la définition que j’ai proposé de l’expérience, il serait exact de dire que si le caillou fait partie de moi, alors je fais partie de lui dans une proportion au moins égale (il peut, en théorie, se voir lui-même en moi). Cependant, s'il n'est pas à même de reconnaître en moi ce qui n'est pas lui, alors dans sa propre observation, je suis lui. De façon similaire, s'il peut me considérer autre mais seulement à l'aune de sa propre composition minérale, alors il se peut que le caillou m'observe comme un caillou, non comme autre chose. C'est d'ailleurs un phénomène observable chez les animaux et qui pose aussi la question de la façon dont les êtres humains se considèrent entre eux.
Il est bien entendu aussi possible que le caillou n'expérimente de moi-même que l'influence mécanique que j'exerce sur lui quand je le lance dans l'eau, et rien d'autre.
L'explication commune biologique sensorielle des êtres n'est pas satisfaisante comme définition métaphysique des capacités d'observation car il n'existe pas dans ce domaine de concept établi permettant d'embrasser la totalité du principe d'observation, seulement des découvertes de capacités physiques et physiologiques. Il est d'ailleurs bien des exemples de perceptions que nous avons du mal à cerner et que nous mettons du temps à découvrir et comprendre, notamment dans la nature sauvage.
Car ce qui n’est pas observé n’est pas nécessairement inexistant, nous n’avons simplement pas la possibilité de constater si oui ou non cela existe car nous n'avons pu déterminer à la fois simultanément de quoi il s'agit et de quoi il ne s'agit pas. On peut résumer cette idée par l'expression célèbre : "Absence de preuves n'est pas preuve d'absence."
Cela implique que les objets que nous observons dans la réalité, à l'exemple du caillou précédemment utilisé, ne le sont possiblement pas dans leur intégralité. Peut-être que le caillou que j'observe est la résultante de phénomènes que j'ignore mettant en jeu des êtres qui me sont imperceptibles, et que la définition que je me figure des cailloux de façon générale est loin d'être complète. Impossible de le confirmer ou de l'infirmer tant que nous n'avons pas la possibilité de nous appuyer sur quelque chose qui pourrait venir le confirmer ou l'infirmer (expérience révélatrice).