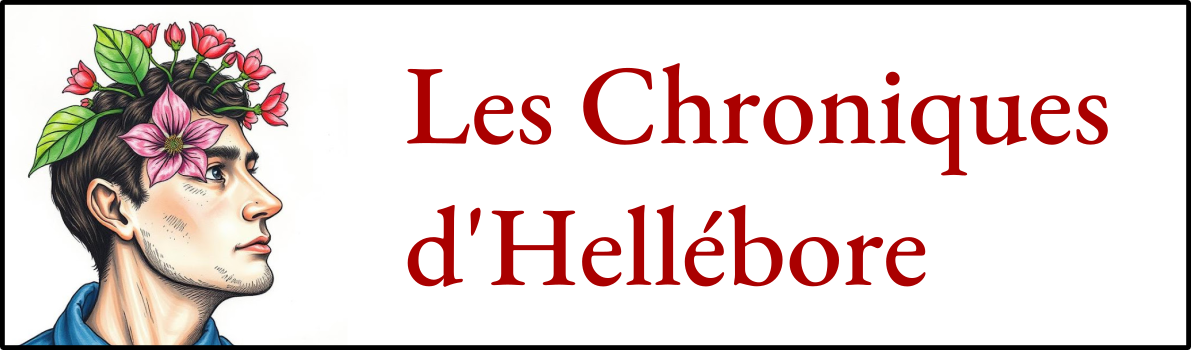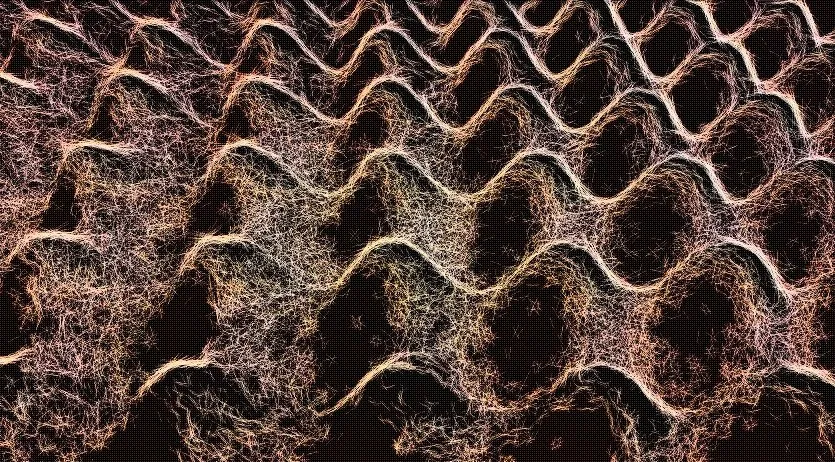Plénitude et souffrance : les impressions primaires


Tout élément de la réalité possède sa dimension sensible réceptive, comme je l’expliquais dans mon article sur l’expérience. Cela suppose que les êtres se trouvent à tout instant dans un certain état. Cet état peut être de trois types :
l’indifférence
la plénitude
la souffrance
L’indifférence ne suscite rien de particulier chez l’être et se trouve donc être un état qui ne produit rien. C’est par exemple le sentiment probable d’un caillou lorsque je le jette dans une mare. Il est assez probable en effet qu’il s’en foute. Partant, je n’ai pas grand-chose d’autre à dire de cet état, si ce n’est qu’il existe et qu’il est même très répandu (on ne saurait être affecté par tout notre environnement, ce serait invivable).
La plénitude est un état de satisfaction. Dans certaines traditions, on l’appelle aussi la joie, non pas dans son acception commune d’éclat de bonheur mais dans le sens de plénitude véritable, de sérénité.
La joie, au sens courant du terme, peut être compris comme la transition d’un état de souffrance vers un état de plénitude, la résolution d’une impression moins heureuse vers une impression plus heureuse, comme un soulagement particulièrement fort. Le chemin inverse est l’affliction.
La plénitude tend à anéantir les impulsions. Elles ne sont en effet d’aucune utilité pour un être heureux qui n’a besoin de rien et n’a rien à rejeter. Cet état ne peut cependant être tout à fait atteint sur Terre compte tenu des conditions d’existence et les êtres les plus heureux sont généralement ceux qui ont surtout réussi à trouver un mode de vie qui leur convient et développé un esprit doté d’un minimum de souplesse.
L’inverse de la plénitude est la souffrance, qui est au contraire particulièrement motrice. Il peut s’agir d’un simple inconfort ou d’une douleur vive, peu importe : c’est un état que nous identifions comme désagréable.
La plénitude et la souffrance influent sur notre balance transactionnelle car nous n’identifierons pas de la même façon nos opportunités en fonction des contextes et de la façon dont nous sommes satisfaits ou non de ceux-ci.
Si je suis malade, par exemple, et que je le vis mal, je vais considérer les transactions possibles qui pourraient m’amener à une meilleure santé et censément une plus grande plénitude. Une fois en bonne santé, je pourrai m’attarder sur les transactions qui pourraient me permettre de rester en bonne santé et de ne pas retomber malade. C’est, dans cet exemple, ce que l’on pourrait appeler ma boussole interne qui m’aide à décider quoi faire et ne pas faire.
Il peut arriver que notre boussole déconne. Cela provient du fait que nos interprétations du monde sont erronées. Par exemple, si j’ai la grippe et que je pense que de me tenir au froid m’aidera à guérir, il est possible que je me trompe, et je serai alors de plus en plus malade.
Certaines personnes argueront ici que lorsque l’on est absolument convaincu de quelque chose, presque tout est possible et que si je suis absolument persuadé que de me tenir au froid m’aidera à guérir de ma grippe, alors cela m’aidera à guérir. C’est possible. Cela signifie simplement que j’aurais alors trouvé une transaction qui me convient davantage qu’une autre.
Je reviendrai dans un article futur sur l’influence de notre esprit sur notre réalité. Ici, le propos concerne le fait d’identifier les transactions qui nous sont favorables.
Mais si mes choix transactionnels ne cessent de m’enfoncer dans mes souffrances, alors c’est probable que ma boussole déconne.
Probable, car ce n’est pas la seule raison possible. En effet, la psyché humaine est complexe et dans ce domaine, beaucoup de choses sont possibles. Je peux par exemple m’infliger à moi-même des souffrances parce que je considère, consciemment ou non, que cela va m’aider à obtenir quelque chose de plus satisfaisant à terme. C’est le cas pour beaucoup d’entre nous en ce qui concerne les exercices physiques afin de « rester en forme ». Ces exercices peuvent être vécus comme une souffrance mais l’objectif transactionnel visé est estimé de valeur positive. En d’autres termes, on consent à des sacrifices pour atteindre un objectif qui nous semble valoir le coup.
Il peut aussi arriver que nous valorisions différemment, non pas des transactions, mais des dimensions de notre être. Je peux par exemple prendre un grand plaisir à me goinfrer lors d’un repas au détriment de ma santé. Ici, j’ai priorisé mon plaisir sensuel, ma gourmandise, et mon état de santé est passé au second plan. Il se peut que je valorise fortement ce que je considère être mon âme au détriment de mon corps et que je m’adonne à des formes de mortifications religieuses parce que je pense que cela m’aide à progresser spirituellement.
Il s’agit en fait de hiérarchisation de nos priorités (un ordonnancement de l’importance de nos plénitudes et de nos souffrances) et la façon dont nous opérons ce tri dépend de nombreuses choses et notamment du contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous pouvons très bien valoriser notre santé à un moment de notre vie, notre vie professionnelle à un autre moment et notre vie de famille à un autre moment encore. Ce que nous identifierons comme plénitude ou souffrance pourra en être largement redistribué. Bien entendu, notre propre identité va influer sur tout cela et celle-ci sera aussi tributaire de notre environnement, notre culture, notre genre, notre âge, etc.
Le détricotage de notre hiérarchisation peut être très révélateur de nos besoins mais cela n’est pas simple, car tout ce qui constitue notre psyché ne nous est pas accessible à loisir, certaines choses sont enfouies.
Ces choses, qui forment notre inconscient, nous pouvons estimer que les révéler est une bonne ou une mauvaise transaction. En effet, en fonction de notre contexte, dévoiler une information cachée de notre perception du monde peut venir chambouler notre psyché au point de produire sur nos vies des changements que l’on pourrait estimer négativement.
C’est une notion très connue en psychologie et dont la précaution thérapeutique peut être résumée par l’expression : « à chacun son rythme ».
Nous avons tous à ce sujet des garde-fous dont le rôle est de ne pas mettre le bazar dans l’organisation de notre esprit et être à même de le réarranger si nécessaire sans démolir tout l’édifice. Il peut arriver que cela survienne néanmoins lorsque nous avons mal estimé une transaction. Nous avons par exemple cru que d’inviter son conjoint à une thérapie de couple était une bonne idée et il s’avère que non, soit parce que nous n’étions pas autant prêts que nous le pensions, soit parce que le praticien n’était pas compétent ou pour une autre raison.
Notre degré de plénitude dépend donc simultanément et contextuellement de manifestations extérieures et de manifestations intérieures. Les premières sont de deux ordres : celles sur lesquelles nous pouvons avoir une influence et celles sur lesquelles nous ne pouvons avoir aucune influence. Les secondes sont de deux ordres également : nos interprétations, parfois erronées, et notre hiérarchisation, qui est changeante en fonction des contextes.
Plus nous sommes conscients de l’ampleur et la teneur de ces quatre paramètres dans nos vies, plus nous sommes à même de rechercher notre plénitude de façon consciente.
Ce qui engendre une dynamique dans tout ceci provient à la fois des conditions extérieures et de notre expérience de la réalité. En effet, il arrive souvent que nous réinterprétions le monde à l’aune de notre vécu et que, ce faisant, nos hiérarchisations changent et également ce que nous pensons être à portée ou non de notre influence. On peut par exemple découvrir qu’une importante source de frustration chez nous concerne en fait des éléments sur lesquels nous ne pouvons agir et ainsi cet élément dégringole dans le bas de notre tableau hiérarchique dans la catégorie « Je n’y peux rien. »
Par cette opération, il est probable que la souffrance engendrée par cet élément diminue car mon esprit va peu à peu cesser de s’y attarder. Elle peut même disparaître, c’est possible.
Cependant, il ne faudrait pas croire que toutes les souffrances peuvent disparaître ainsi, contrairement à ce que racontent certains gourous. Si je me plante un clou dans le pied, par exemple, ce n’est pas en acceptant le clou dans mon pied que la douleur va disparaître. Le clou est véritablement une souffrance pour mon corps et le mieux que je puisse faire c’est de l’enlever. Cependant, une fois enlevé et la blessure guérie, il ne sera probablement pas utile que je m’inflige d’y repenser tous les jours pendant des années.
Les personnes qui parviennent à ne plus ressentir la douleur physique, à l’instar des anesthésies sous hypnose, ne « transcendent » pas la douleur, elles focalisent simplement leur attention sur autre chose et éloignent temporairement de leur identification courante l’élément douloureux. Cela ne supprime pas pour autant la blessure et la souffrance du corps (nerfs à vif, cellules éclatées, inflammation). Au mieux, on pourrait dire que nous usons de notre cerveau pour ne pas s’encombrer de cette réalité en particulier. C’est d’ailleurs un mécanisme qui existe aussi pour les traumas et qui possède des limites de supportabilité au-delà desquels notre inconscient déclenche des mécanismes de guérison, qui ne sont d’ailleurs pas toujours simples à gérer. En effet, ce n’est pas en ignorant ses problèmes qu’ils disparaissent !
Limiter notre focalisation sur nos souffrances à ce qui nous est strictement nécessaire pour gagner en plénitude a le mérite de nous rendre pertinents et efficaces quant au choix de nos transactions sur tous les plans et éviter de broyer du noir ou de se bercer d’illusions. Le talent complémentaire à cette approche consiste par ailleurs à réussir à identifier véritablement les choses sur lesquelles nous pouvons agir ou non. Si je considère que les gens sont cons mais que je n’y peux rien, autant cesser d’y prêter attention lorsque c’est possible ou tout du moins ne pas trop s’y attarder. Cependant, si j’estime que les gens sont cons et que je peux y faire quelque chose, en fonction de ma hiérarchisation interne, il se peut que je me mette à consacrer un temps certain à essayer de rendre les gens moins cons.
Sur ce point, il est inutile de projeter sur autrui son propre avis sur soi-même, car ce dont sont capables les gens en termes d’influence sur le monde est très variable et ce qui peut apparaître inaccessible pour les uns peut apparaître envisageable pour les autres. La différence réside principalement dans l’ambition que chacun a pour lui-même et dans sa puissance intrinsèque pour en être à la hauteur.
Mes explications présentes partent du principe que tous les êtres préfèrent la plénitude à la souffrance dans la mesure où ils perçoivent celle-ci comme injustifiée (dans la mesure où ils estiment qu’elle ne peut pas apporter à terme plus de plénitude que de souffrance). Cette affirmation provient de mon observation du monde et je tends à penser qu’elle est une vérité universelle, bien que je ne puisse pas la prouver définitivement. Bien entendu, plus nous prenons de la hauteur, plus nous voyons ces êtres entrer en synergie et en antagonisme et si la vie était pure plénitude, il n’y aurait pas de souffrance du tout. Je constate cependant que tant que nous délimitons un contexte d’étude, nous pouvons observer une recherche de plénitude de la part des ensembles vivants en fonction des moyens dont ils disposent. On pourrait dire que la vie cherche en permanence à lutter contre sa désagrégation, dans une lutte sans fin entre néguentropie et entropie.
La loi de conservation des forces suggère à ce propos qu’il existe en définitive autant de plénitude que de non plénitude et de souffrance que de non-souffrance. Cela peut paraître assez désolant et pourrait inciter à une forme de nihilisme mais il est important de comprendre que l’absence de plénitude n’est pas la souffrance, et inversement. D’ailleurs, dans la mathématique, l’inverse de quelque chose n’est pas son contraire. Ne pas être heureux, ce n’est pas obligatoirement souffrir, c’est peut-être simplement ne rien ressentir de particulier, ni bonheur, ni malheur. Aussi, l’inverse d’une personne heureuse, c’est une non-personne non-heureuse, c’est quelque chose dont nous aurions du mal à déterminer la nature.
Certaines sagesses, notamment orientales, proposent d’atteindre des états d’égalité d’humeur pour accepter pleinement la réalité de l’être. Cela me semble problématique dans le mesure où la recherche de plénitude est consubstantielle à l’être incarné et à la réalité. Le mieux qui puisse être accompli à mon sens sur la question est d’abord de se décider à accepter ou non le jeu de l’expérience sensible et créative en sachant qu’elle ne peut prendre de sens véritable que dans un contexte (formuler le désir de vivre, en somme) et ensuite adopter l’approche que je viens précisément de présenter dans cet article, à savoir travailler sur ses souffrances lorsque cela s’avère utile.
Si l’on se décide à ne pas accepter de jouer le jeu, alors l’équanimité, la désidentification et la recherche de désincarnation prennent sens, mais il ne s’agit pas ici d’une acceptation de l’existence, c’est tout l’inverse : il s’agit d’un rejet de celle-ci.
J’aurai l’occasion de revenir sur ces différents sujets dans des articles dédiés.
Par ailleurs, il n’est pas incohérent de voir en toute souffrance la source potentielle d’une plénitude à venir et en toute plénitude la source potentielle d’une souffrance à venir. En effet, puisque nous ne connaissons pas à l’avance tous les contextes que nous allons expérimenter, tout est possible en la matière. Cela signifie que c’est bel et bien notre interprétation du monde qui va déterminer, non pas ce qu’éprouve notre être, mais ce que ce dernier va pouvoir faire de ce qu’il éprouve. En cela, on ne peut tout à fait trancher quant à l’utilité ou l’inutilité d’une expérience et il serait même plutôt exact, au global, de considérer que tout a une raison d’être d’une manière ou d’une autre. Sur ce point, ce sont les techniques d’anticipation des transactions qui peuvent varier : nous sommes plus ou moins pessimistes et optimistes en fonction des situations.
Dans l’article suivant, j’expliquerai les dynamiques que nous pouvons initier à la suite des impressions que nous ressentons.