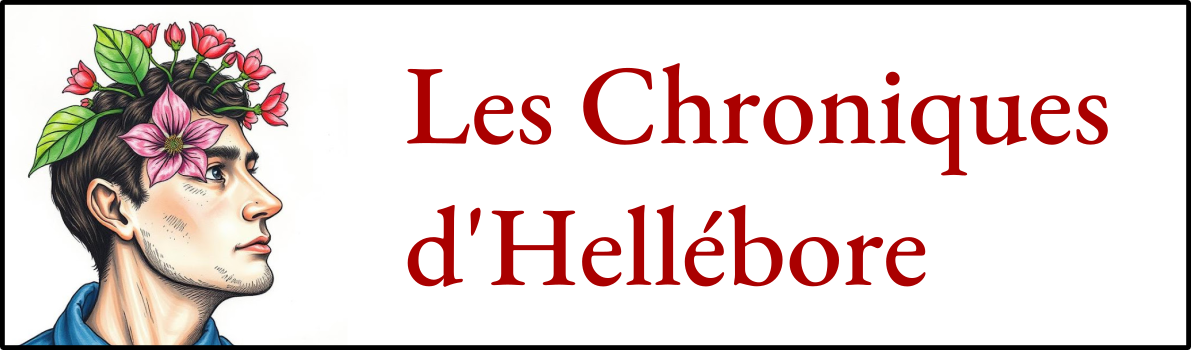L'ordre social et la morale


L'ordre social représente la façon dont un groupe humain va trouver son propre modèle d'interactions sociales en fonction de sa nature, de son environnement, de ses besoins et de ses aspirations.
Ce modèle est constitué d'un ensemble de réflexes, d'habitudes et de codes permettant au groupe de minimiser sa violence intérieure, notamment pour mieux faire face à la violence extérieure.
En effet, moins un groupe est capable d’anticiper la résolution de ses propres tensions internes de manière durable par l’introjection de mœurs et de codes sociaux et moraux, c’est-à-dire, moins il sera capable de prévenir ses conflits internes, plus il dépensera d'énergie à résoudre ces derniers de manière curative, c’est-à-dire, après qu’ils aient éclatés, comme un couple passant son temps à se crier dessus ou une équipe de sport dont les querelles d’égos déclencheraient régulièrement des rixes.
Afin de faire face à la violence qui lui est extérieure, il sera pour ce groupe bien plus efficace de trouver des manières de fluidifier les interactions entre ses membres. Cela se manifestera par l'instauration d'un système légal et judiciaire, si rudimentaire fusse-t-il. Cela participera aussi à la culture propre à ce groupe, où les attitudes et les attentes se solidifieront à mesure qu'elles auront été approuvées et donc reconnues comme satisfaisantes (efficaces selon la propre idiosyncrasie du groupe, c'est-à-dire sa perception du monde, ses référentiels). C'est d'ailleurs de cela que provient la morale d'un peuple et l'expression de ses valeurs.
Je parlais à l’instant de violence extérieure aux groupes : quelle est-elle ?
Tout d'abord, on peut penser aux autres groupes, parfois en contradiction les uns avec les autres et pouvant chercher à résoudre par le conflit ce qu'ils identifient comme un problème ou une menace.
Ensuite, la nature elle-même, ayant ses propres mécanismes et ses propres besoins, de sorte qu'un groupe humain, en pleine nature et épargné par des conflits avec d'autres groupes ne cessera pas de chercher des solutions aux défis imposés par la nature. Et notamment le fait de devoir boire, manger, dormir, se protéger des bêtes sauvages ou de la maladie.
Un ordre social qui perdure doit pouvoir répondre à ces besoins. En fait, un ordre social défaillant ne peut avoir que trois issues possibles : la mort du groupe, une modification de l'ordre en question ou bien la fusion de ce groupe dans un autre par nécessité.
La mise en place de l'ordre social d'un groupe montrera toujours les mêmes caractéristiques, à savoir des individus qui auront tendance à exercer une autorité et à proposer un ordre qui leur semble satisfaisant en fonction des contextes, les meneurs, et des individus qui accepteront dans une certaine mesure cette autorité et appliqueront plus ou moins bien cet ordre, les suiveurs. Cette dyade existe partout dans la nature où le principe de société existe. On peut dire prosaïquement une élite et un peuple, un chef et une troupe, et les premiers apparaissent toujours moins nombreux que les seconds. À ce titre, la représentation en pyramide des hiérarchies humaines est assez correcte, et montre d'ailleurs que le pouvoir exercé par l'élite d'un peuple sur ce dernier tend à former des espaces intermédiaires d'exercice de ce pouvoir, comme l'autorité d'un roi que l'on retrouve chez ses baillis. Il est cependant important de ne pas oublier, comme je le précisais dans mon article sur les trois caractères sociaux, que ces structures hiérarchiques pyramidales ne sont pas nécessairement incarnées par les mêmes personnes en permanence dans tous les contextes, bien qu’il existe des profils, obsédés par le contrôle, qui tendent à vouloir dominer les autres en toutes circonstances.
Le troisième caractère, autonome, dont j’ai déjà parlé dans le même article, jouera quant à lui le rôle d’empêcheur de tourner en rond, en participant parfois à la consolidation d’un ordre social et parfois à sa déstabilisation. En effet, son caractère non conformiste par essence tend à ouvrir des possibles que personne d’autre ne peut ouvrir. Ces possibles pourront autant servir à transformer l’ordre social en place qu’à en consolider un autre par ailleurs.
L'origine de la chefferie d'un groupe est la reconnaissance par l'ensemble de ce groupe des capacités des individus qui composent cette chefferie à minimiser la violence interne au groupe de la manière la plus satisfaisante qui soit en fonction des opportunités présentes (sinon, le groupe tendrait organiquement à changer sa chefferie). Cela n'empêche pas par ailleurs plusieurs choses : que certains membres du groupe ne soient pas satisfaits de leurs élites (sans pour autant trouver de remplaçants prometteurs), que les capacités cognitives de la société permettant cette reconnaissance puissent être manipulées (propagande), que la violence du groupe, observée par un groupe extérieur, puisse paraître grande et éventuellement excessive (choc culturel) et enfin que la conséquence directe d'un groupe qui rejette ses élites sans pour autant parvenir à les remplacer est un groupe humain qui tend à mourir et fusionnera tôt ou tard avec un autre groupe (phénomènes antagonistes internes).
De plus, il est erroné d'analyser les rapports de force en termes de nombre (et, nous l'avons vu, les élites apparaissent systématiquement beaucoup moins nombreuses que les gens sur lesquels elles exercent leur pouvoir) : il est nécessaire de les analyser en termes de puissance et d’expression de domination. De fait, et c'est ce qui explique pourquoi une personne seule peut parfois tenir en respect des milliers d'autres, c'est la puissance manifestée par les individus et leur volonté de dominer qui déterminent leur impact sur un groupe humain. Et à ce titre, le différentiel peut avoir des ordres de grandeur du simple au double, au centuple et au-delà.
Il faut ajouter à cela le charisme des chefs, qui a pour effet de combiner leur propre puissance dominatrice à celle des personnes sur lesquelles ils exercent une influence, de sorte que l'orientation donnée au groupe s'en trouve renforcée par une adhésion conjointe de toutes les puissances individuelles, masculines et féminines. Il est très courant d’observer des personnes suiveuses se faire relais des volontés des chefs, parfois de façon extrêmement vive.
L'existence d'élites au sein d'une communauté est systématique et ces dernières se démarquent donc par leur puissance et leur caractère.
Croire que les élites supérieures d'un peuple sont toujours celles qui détiennent le pouvoir est en revanche incorrect. En réalité, les personnes qui exercent le pouvoir sur un peuple sont des élites parmi d'autres et il est relativement ordinaire de constater des tempéraments d'élites s'exprimer à n'importe quelle couche de la société. Ces personnalités, souvent assez remarquables (bien qu'il puisse y avoir des exceptions), aspirent toujours à la conquête du pouvoir, peu importe l'ampleur de celui-ci : du pouvoir sur soi-même au pouvoir sur le monde, en passant pour toutes les intermédiarités possibles. Leur dynamique est donc toujours ascendante d'un point de vue de la pyramide des autorités. Ainsi, des personnes ayant un caractère dominateur et puissant peuvent très bien ne pas avoir le pouvoir, bien qu’elles cherchent à l’obtenir. Il s’agit d’ailleurs d’un profil étroitement surveillé par les potentats en place car il représente évidemment une rivalité.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre un équilibre trouvé grâce à la minimisation des violences (une maximisation de la paix) avec un équilibre trouvé entre les pôles masculins et féminins. Un peuple apaisé peut avoir un masculin débordant sur le monde ou un féminin consommant le monde, de même qu'un peuple parfaitement autarcique peut avoir des conflits internes sérieux. Cela dépend des contextes et notamment de l'essence des peuples, ce dont je reparlerai plus tard.