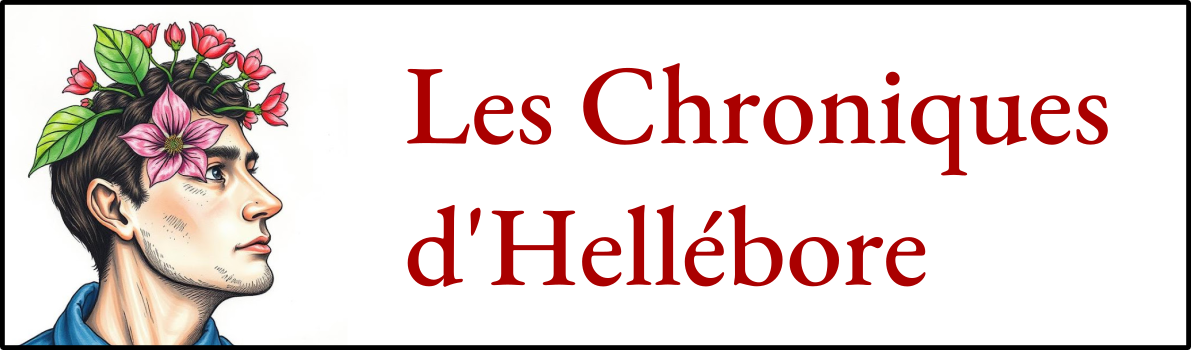L'exercice de la vérité


La vérité s'approche toujours par une forme de recherche, c'est-à-dire par une démarche logique stricte permettant d'actualiser les subjectivités, et qui peut se produire de façon inconsciente ou bien consciente (pour cette dernière, c'est ce que doit appliquer toute activité scientifique digne de ce nom, on peut aussi parler de dialectique). Cela n'a d'ailleurs pas grand importance car il est facile de rencontrer des situations où notre intuition (recherche inconsciente de la compréhension du monde) s'en sort mieux que notre réflexion (recherche consciente) et d'autres situations où c'est l'inverse.
Ce que nous avons vu jusqu'à présent nous permet d'ores et de déjà d'affirmer que tout ce que j’écris dans mes articles n’est que contextualisation d’une réalité qu’aucun mot ni aucune pensée ne saurait saisir parfaitement dans son ensemble.
Cependant, intégrer cela permet de définir précisément des contextes pour lesquels le vrai et le faux ne peuvent logiquement cohabiter. L'ensemble de ces éléments vrais forment ce que l'on pourrait appeler des sous-vérités, plurielles et partielles, car leur valeur n'a de sens que dans un contexte. Or, nous avons vu qu'il existe des éléments qui transcendent les contextes, ces fameux éléments communs sans lesquels l'observation du réel ne serait pas possible. Ainsi, il existe une vérité, au singulier, vers laquelle la pensée peut tendre sans jamais l'atteindre (puisque cette dernière prend toujours pied dans un contexte plus ou moins grand), et qui contredit donc l'idée selon laquelle tout est relatif. En réalité, c’est la pensée humaine qui tend à être toujours relative, mais la vérité, elle, et à l’instar de Dieu, est absolue. Cela signifie également que, contrairement à ce qu'avancent les positions relativistes, il existe un gradient infiniment extensible entre la vérité et l'erreur, et donc une ancre, une contrainte à la raison, qui ne peut établir n'importe quoi n'importe comment.
Une idée pourra donc être vraie ou fausse selon le contexte auquel elle se rapporte, ce qui demande de définir correctement les contextes pour pouvoir ensuite confronter les idées et en retirer celles qui sont les plus proches de la vérité. En d'autres termes : réactualiser les subjectivités pour les faire tendre vers la vérité, raffiner les interprétations en quelque sorte (l’une des deux faces de l’expérience, comme je l’expliquais dans mon article sur le sujet).
C'est par cette discipline mentale que l'on pourra tendre vers une pensée honnête et cohérente.
Il arrive aussi parfois d'élaborer dans un même contexte bien défini deux affirmations contradictoires. Il conviendra alors de mettre à l'épreuve ces affirmations pour en retirer leur part de vérité, à savoir que seule l'une des deux est vraie, que les deux sont fausses ou que leur contradiction n'est qu'apparente.
Nous pouvons également tenir pour exact le fait que définir un contexte de réflexion le plus large possible (c'est-à-dire englobant un maximum de variables et de cas concrets différents, ce qui revient à minimiser le sectionnement mental de la réalité, évoqué précédemment) est une manière de mobiliser cette réflexion au plus proche de la vérité, car alors ce qui pourra en être conclu concernera un grand nombre de sous-contextes. Mais c'est aussi cette approche qui est la plus difficile puisqu'elle suppose de supporter l'épreuve du réel dans de nombreux exemples. De plus, cette approche se devra d'être implicite pour permettre d'aborder des contextes plus restreints de manière approfondie. Il ne serait pas possible de se concentrer sur un sujet précis si l'on devait prendre le temps de redéfinir l'ensemble de la réalité à chaque fois. C'est d'ailleurs de cette façon que je rédige mes articles : bien que je fasse de temps à autre des rappels, ce que j’écris est par la suite considéré comme implicite afin d'avancer dans le propos.
Afin de faire preuve d'exhaustivité, il nous faut revenir un instant sur l'idée de non-contradiction dans l'étude du réel. C'est un choix arbitraire car il suppose d'emblée que deux affirmations parfaitement contradictoires ne peuvent être simultanément vraies pour décrire le réel. Ce choix est arbitraire mais n'est pas absurde : il est la version la plus intuitivement évidente de l'explication du réel. Cependant, il est possible de considérer que la réalité puisse être illogique et supporter simultanément deux éléments inconciliables. Cela n'est, de fait, pas logique mais nous pourrions à la rigueur l'accepter comme fait.
Cette idée est plus théorique que fonctionnelle car il est rarissime de rencontrer des cas contradictoires et lorsque cela arrive, le temps et la connaissance finissent le plus souvent par en dévoiler l'illusion. Pourtant, il est nécessaire de l'aborder pour ne pas absolument la rejeter, ce qui amputerait en quelque sorte la démarche de compréhension logique du réel.
Appelons chaos ce qui n'est pas accessible à la logique humaine et ordre ce qui l'est. Si notre observation et notre interprétation du monde nous amènent à reconnaître l'existence d'un ordre par la réalisation d'anticipations suffisamment durables pour être appelées lois, témoignant en cela de l'existence d'une vérité, elle nous amène également volontiers à reconnaître l'existence d'un désordre, qu'il fut apparent ou non (nous ne pouvons en effet qu'ignorer son ampleur), et par là d'un chaos.
Lors, se pose une dichotomie assez commune : en tout état de nos observations, soit chaos et ordre coexistent visiblement, soit tout n'est qu'ordre et ce que nous appelons chaos n'est que la résultante de notre incapacité à penser totalement le monde de manière ordonnée.
Il n'y a pas de réponse à cette question tout simplement parce que la définition même du chaos est de ne pas pouvoir être interprété par l'esprit humain. Gardons simplement en mémoire que la volonté d'étendre la connaissance de la vérité est tout ce qui compte lorsque nous faisons œuvre de comprendre la réalité et que cette volonté peut s'appliquer de façon identique dans l'une ou l'autre des deux hypothèses.
Aussi, à partir des éléments déjà cités, est-il aisé de déterminer que notre subjectivité d'observateur humain rend la recherche de cette vérité éternelle, y compris la recherche de vérité sur soi-même, car alors, ce que nous considérons être nous-mêmes, par la connaissance que nous en avons (réalité expérientielle), est impossible à définitivement embrasser du fait même de la réduction nécessaire du réel par la pensée.
Proposer une vérité complète demandera donc d'avancer des arguments arbitraires non justifiables (axiomes), tandis que de n'apporter que des arguments justifiables ne formera pas de vérité complète (connaissance contextuelle).
Par ailleurs, l'idée de parfaitement se connaître soi-même conduit à un paradoxe d'observation où je me dois d'être à la fois moi-même et non moi-même pour m'identifier totalement. Cela revient à considérer que ce "moi-même" devient une partie seulement de l'être observant que "je suis" et donc que la notion même du "je" se relativise jusqu'à éventuellement s'effacer dans une connaissance absolue du monde, inaccessible aux êtres observants réels du fait de la limitation de leurs composantes passives (sensibilité) et actives (influence).
Je reviens un instant sur ces deux notions de sensibilité et d'interprétation (ou de décodage).
Tout d'abord, la sensibilité de l'être observant peut-elle se tromper ? La réponse est non, car il ne s'agit pas d'un phénomène où l'être observant agit, il y est soumis, simplement. Il est possible que sa réception d'un phénomène soit partielle, mais il n'est pas possible qu'elle soit erronée, car il n'y a pas d'espace d'erreur possible. On pourrait dire que la sensibilité d'un être est authentique.
L'interprétation d'un phénomène perçu ouvre en revanche la porte à l'erreur, à la mauvaise interprétation. Ce cas est facile à expérimenter avec les illusions d'optiques (et plus largement sensorielles), où nous croyons voir un instant quelque chose avant de nous apercevoir qu'il s'agit d'autre chose. L'information reçue n'est pas erronée, c'est la façon dont nous l'analysons qui l'est.
À ce propos, il serait tentant de considérer qu'un ensemble de subjectivités a davantage de chances de tendre vers l'objectivité qu'une seule. Mais c'est une erreur. Une seule subjectivité ayant connaissance des mécanismes favorisant la recherche de vérité et s'y appliquant sera toujours plus objective qu'une foule de subjectivités ignorantes. Car les dynamiques collectives ne sont pas censément que pur profit pour les individualités, elles peuvent tout aussi bien engager ces dernières sur des voies erronées, avec la force persuasive de la pression sociale qui les caractérisent.
De la même manière, et pour les mêmes raisons, l'intelligence ne suffit pas à produire une recherche honnête de la vérité. L'intelligence peut au mieux être considérée comme un catalyseur, mais elle ne détermine pas la propension à la vérité. Une personne intelligente qui ne peut souffrir l'exercice de la vérité pourra user de toutes ses facultés pour justifier ses erreurs. De même qu'une personne peu intelligente pourra faire montre de fulgurances certaines. À ce titre, l'intelligence, en plus de son aspect catalytique, est à comprendre comme un outil de mise en forme, notamment à des fins de diffusion de la pensée, mais elle demeure étrangère au principe de vérité, qui doit se voir comme un principe lié aux dispositions intérieures de l'être, ce que nous reverrons plus loin. Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins que certaines réalités ne peuvent être décrites que par un exercice intellectuel intense, mais la justesse de cet exercice trouve sa condition ailleurs.
Dans un autre registre, nous pouvons déduire des définitions précédentes que tous les composants de la réalité a minima, c'est-à-dire observable, admettent nécessairement deux choses contraires : une éternité et une temporalité. Leur éternité s'explique par le fait qu'une chose qui a existé ou existe préexiste déjà dans la réalité qui la voit naître et continuera d'en faire partie (principe de coexistence, rappelant d'ailleurs la célèbre réflexion d’Antoine Lavoisier : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"). Leur temporalité s'explique parce que leur observation même suppose une forme et donc une temporalité : un début et une fin.
Cela signifie aussi, comme je l’ai évoqué précédemment, qu'une essence qui ne se manifeste plus peut théoriquement reprendre forme à tout moment, bien que nous ne puissions en être certains. Cela signifie aussi qu'elle puisse éventuellement perdurer sous une forme bel et bien manifestée, mais inaccessible à l'observation, comme c’est le cas parfois dans la transmission de caractères génétiques non immédiatement visibles.
Par ailleurs, le simple fait de pouvoir considérer ces notions signifie que nous avons en nous à la fois la notion du temps et du non-temps. Nous avons donc en nous une dimension temporelle, à même d'aborder les notions d'éphémérité et d'éternité et une dimension hors du temps.