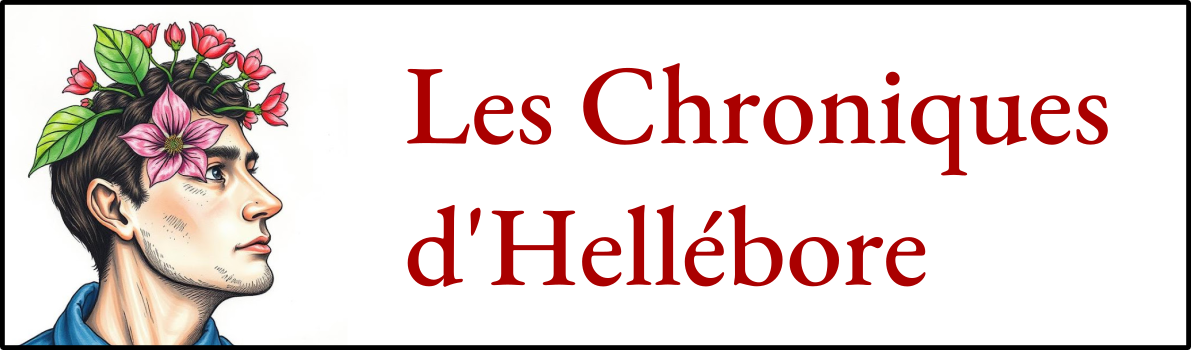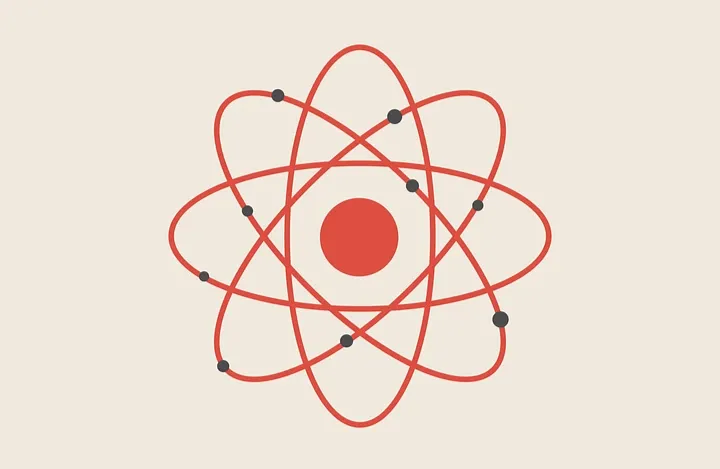Les trois caractères sociaux


Tout groupe humain dessine plus ou moins les mêmes dynamiques internes : on y trouve des meneurs, des suiveurs et des profils de tendance autonome.
Dans cet article, je vais expliquer leur rôle et leurs limites et la façon dont ces profils émergent et interagissent.
Les meneurs sont des personnes qui recherchent le pouvoir et qui souhaitent l’exercer. La raison de ce désir dépend de la façon dont ils s’identifient à leur égo, plus ils sont centrés dessus, plus ils recherchent le pouvoir pour leur propre profit, c’est donc le cas des femmes et des hommes égoïstes.
Les meneurs sont nécessaires à tout groupe car sans eux, le groupe n’irait nulle part et éclaterait immédiatement en groupes plus petits.
Pour illustrer mon propos, je vais prendre l’image d’un train. Celui-ci est à l’arrêt, sur ses rails. Le meneur, en ce cas, c’est à la fois le conducteur et le chef de bord, c’est la tête pensante et décisionnelle. C’est lui qui décide où on va, quand et il a aussi généralement une assez bonne idée du comment.
Bien sûr, plus un groupe est grand et varié, moins un meneur est à même de tout connaître pour tout décider, c’est pour cette raison qu’il délègue.
Les suiveurs forment les équipes techniques. Ils ne décident pas de la direction et du planning, mais sans eux, le train ne bougerait pas non plus.
Enfin, les profils autonomes, eux, s’occupent de deux choses : ils explorent le terrain pour poser des rails et ils inventent de nouvelles solutions techniques pour le train. Ce sont les véritables designers et les premiers ingénieurs. Ils ont globalement besoin du reste du groupe de façon bien moins impérieuse que les deux autres mais ne sauraient s’en passer complètement.
Ces trois caractères sont très différents mais absolument indispensables les uns aux autres. S’il en manquait un, le groupe ne tiendrait pas. Ils forment ensemble la totalité des passagers du train et leur existence en tant que groupe justifie en fait l’existence même de ce train.
Il faut cependant comprendre une chose d’absolument essentielle sur ce sujet : ce n’est pas seulement l’identité des gens mais aussi le contexte qui va déterminer qui va adopter tel ou tel caractère. En effet, nous possédons tous en nous une dimension de meneur, de suiveur et d’électron libre. Ces trois dimensions sont plus ou moins représentées en chacun de nous. En ce qui me concerne, par exemple, ma dimension autonome est très grande, ensuite vient ma dimension de meneur et puis enfin ma dimension de suiveur, assez faible.
Il existe aussi des personnes qui ont un caractère principalement meneur ou suiveur mais qui sont très peu autonomes. Il existe en fait, tous les cas de figure possibles mais il n’existe pas de cas où l’un de ces caractères est absent ou de cas où serait présent un quatrième caractère.
Lorsque nous sommes seuls, c’est notre caractère autonome qui est sollicité. C’est là où nous devons décider pour nous-mêmes. Les personnes fortement autonomes garderont cette approche dans un contexte social là où les suiveurs et les meneurs révéleront une certaine soumission (laisser les autres décider pour soi) ou une certaine domination (décider pour les autres).
Chaque fois que nous nous trouvons dans un groupe humain, ce triptyque relationnel se met en place et plus les caractères sont tranchés, plus il se met en place facilement et rapidement.
Le cas de la relation à deux ne déroge pas à la règle car les dimensions respectives des deux personnes s’exprimeront dans tous les cas. C’est, encore une fois, le contexte qui va déterminer la façon dont cela va se manifester et notamment le type de relation, la personnalité des acteurs (l’ampleur de leurs trois dimensions caractérielles) et la situation dans laquelle ils se trouvent.
En revanche, si des personnes ayant des proportions caractérielles similaires se retrouvent à devoir cohabiter, cela génère des phénomènes transitoires à la stabilisation qui seront d’autant plus longs et potentiellement violent que la similarité sera grande.
Des personnes ayant un caractère de meneurs à peu près équivalent vont souvent entrer en conflit pour déterminer qui aura le droit de diriger le groupe. Dans certains cas, ces profils peuvent aussi coopérer, lorsque la situation semble l’exiger, mais leur relation est en général une bombe à retardement car sitôt qu’une nouvelle situation se présentera où l’un des deux pourra régner seul, un conflit éclatera.
Des personnes ayant un caractère de suiveurs se retrouvant ensemble vont plutôt générer un flottement où rien ne se passera de façon coordonnée et décisive. En fonction des contextes, ce flottement peut être bénin ou très grave, il peut même conduire à la mort du groupe. Cependant, un meneur émergera toujours et ce sera de fait la personne du groupe qui possède en elle le caractère de meneur le plus fort. Peu importe que ce caractère apparaisse éventuellement faible dans un autre contexte, dans ce contexte-ci, il sera le plus fort et donc le meneur.
Enfin, des personnes de tempérament autonomes réunies ensemble tendront à faire chacune leur vie dans leur coin sans trop coopérer. Cela peut fonctionner dans certains contextes, cependant, dans un grand nombre de situations, ce format sous-optimisé de coopération, qui produit donc une dynamique collective très faible, mettra en danger le groupe.
À ce propos, « mettre en danger le groupe » peut avoir plusieurs significations. Il peut s’agir d’un danger physique, éventuellement létal, mais il peut aussi s’agir d’un danger identitaire. En effet, un groupe faible ne verra pas forcément ses membres disparaître physiquement mais potentiellement s’égailler vers d’autres groupes. Ainsi, le groupe initial, avec son histoire et ses particularités, disparaîtra, mais ses membres continueront de vivre par ailleurs.
Les proportions caractérielles que je viens de décrire sont aussi variables en fonction de la raison d’être du groupe. Par exemple, pour un même groupe, on ne trouvera pas forcément les mêmes meneurs pour un atelier de mosaïque ou pour une urgence incendie. Dans le premier cas, s’il se trouve un mosaïste dans le groupe, il y a fort à parier que ce soit lui qui soit en charge de l’atelier, le dirige et soit aussi à même de dire aux personnes qui le suivent si ce qu’elles font est acceptable ou non pour le groupe (ne pas abîmer les outils par exemple ou bien laisser à chacun suffisamment de tesselles). Dans le second cas, un pompier serait tout indiqué pour diriger les opérations de secours.
Les exemples que je donne ici sont circonstanciés à des fins d’explication mais il existe un profil type de meneur qui n’a pas besoin de l’être. On pourrait dire que, au sein d’un groupe, il est en permanence en situation de meneur. Le contexte d’expression de ce caractère de meneur est en fait l’existence même. Les personnes ayant ce profil ont donc tendance à ne jamais cesser de diriger un tant soit peu. Cela peut prendre plusieurs formes. En effet, plus ces personnes sont centrées sur elles-mêmes, plus elles essaient de diriger alors même qu’elles n’en sont pas toujours légitimes : que le mosaïste explique au pompier comment éteindre un incendie serait bien malvenu. Cependant, il existe des personnes de ce type pour qui l’objectif est de prendre authentiquement soin du groupe. Ces profils ont d’ailleurs un talent certain pour déterminer quelle personne il convient d’écouter dans telle ou telle situation. Cela se manifeste en l’occurrence comme un transfert temporaire d’autorité mais le groupe sait, consciemment ou non, que sa hiérarchie n’a pas pour autant été modifiée, car ce transfert est justement consenti et supervisé par leur chef. On peut le voir comme une nomination de ministres ou de lieutenants.
Cette manière de diriger est celle qui garantit le plus au groupe de chances de se maintenir dans le temps et de croître et s’épanouir. On peut y voir du bon sens, tout simplement. Cependant, de nombreuses personnes ne le voient pas, et ont tendance à reconnaître de l’égoïsme dans toutes les décisions prises par les personnes qui les dirigent. Cela provient de plusieurs facteurs, qui sont très contextuels à notre époque individualiste :
de plus en plus de profils de meneurs sont effectivement extrêmement égoïstes, soit à leur propre niveau individuel, soit pour leur propre caste et aucune autre ; ainsi les meneurs dévoués à leur groupe ont-ils tendance à être noyés dans la masse
de plus en plus de personnes prétendent avoir des caractères qu’elles n’ont pas, et puisque, dans notre imaginaire collectif actuel, les caractères du meneur et de l’autonome sont souvent perçus comme une supériorité anthropologique, certaines personnes affectionnent de s’y assimiler alors même qu’elles ne possèdent que très minoritairement les traits correspondants
la dialectique marxiste de lutte des classes a inculqué depuis des décennies à de nombreuses personnes que le principe hiérarchique est l’ennemi principal du bonheur et que toute velléité de direction est donc une oppression aliénante ; cette dialectique ne peut conduire qu’au chaos, à la souffrance et à la mort (j’aurai l’occasion d’y revenir dans d’autres articles)
De fait, la méconnaissance de presque tout le monde à propos de ce que je décris dans cet article provoque très souvent des réactions qui manquent de discernement.
On voit par exemple de nombreuses personnes de tempérament plutôt autonome s’énerver à n’en plus finir contre les « moutons », les gens qui suivent les ordres sans trop réfléchir ou les questionner. Ce que ces personnes ne comprennent pas, c’est que ces suiveurs ne sont pas capables de le faire dans le contexte en question. Et cela ne provient pas nécessairement d’un manque d’intelligence, c’est simplement parce que le rôle qu’ils endossent dans ce contexte est celui de suiveur parce qu’ils ont intérieurement identifié que c’était la meilleure chose à faire (leur balance transactionnelle se révèle positive dans le contexte en question).
Ces mêmes profils à tendance autonome pensent souvent qu’il faut faire en sorte de « réveiller » les gens et de leur montrer que cette attitude suiveuse qu’ils adoptent n’est pas la bonne. C’est là une attitude, non pas autonome, mais de meneur. En effet, ces personnes considèrent savoir ce qui est bon pour le groupe et cherche à l’appliquer sur celui-ci, il ne s’agit donc pas d’une attitude d’électron libre mais bien de meneur. Cependant, puisque, pour la plupart de ces personnes, leur dimension de meneur est réduite, cette volonté ne s’applique que mollement et se transforme en général rapidement en frustration.
Car il faut bien comprendre que lorsque nous adoptons l’un des trois rôles, cela ne nourrit pas entièrement notre être. Pour le faire, il faut que nous disposions de contextes où nous pouvons exprimer nos trois dimensions caractérielles de façon proportionnée à leur ampleur. Cela signifie que les personnes autonomes qui s’agacent contre « les moutons qui écoutent ce que dit la télé », qui désirent les faire changer à leur façon mais ne le font finalement pas plus que ça, sont en fait dans un état oscillant où la tentation de prise de pouvoir est présente mais où leur dimension de meneur est trop réduite pour qu’elles aillent au bout de la logique que dicte leur sentiment.
De telles situations, lorsqu’elles durent, peuvent générer une grande souffrance intérieure. Être contraint à l’autonomie alors même qu’on a un fort tempérament de suiveur est par exemple difficile, de même pour les meneurs que l’on oblige à suivre, etc.
Moins une société réussit à proposer de contextes où les tempéraments de chacun peuvent s’exprimer à la mesure de leur nature, plus elle tend à se déstabiliser puis à s’autodétruire.
Toutes ces dynamiques ont une base assez simple mais des expressions complexes car les contextes changent sans cesse et les groupes aussi. On se retrouve donc avec des moments de paix et d’autres de conflit, des moments statiques et d’autres plus dynamiques, des moments de stabilité et d’autres de redistribution des rôles.
D’autres sentiments typiques existent. Par exemple, il est très fréquent que des personnes suiveuses s’énervent contre des personnes autonomes, car elles n’appliquent pas nécessairement les directives du meneur et leur paraît donc mettre en danger le groupe. Ce phénomène peut être à l’origine de lynchages, d’exclusions ou même de mises à mort. Elles ont souvent l’impression que l’autonome s’adonne à la provocation en ne « faisant rien comme tout le monde ». Si c’est parfois vrai, c’est aussi souvent faux car l’autonome fait surtout comme il l’entend sans se soucier de ce qu’en pensent les autres, non parce qu’il les défie mais parce que c’est son fonctionnement normal.
Les meneurs, eux, balancent entre méfiance et attirance pour les autonomes. Ils s’en méfient car les autonomes ne leur obéissent pas vraiment et cela peut grandement les énerver. En effet, une personne qui échappe au contrôle d’un meneur peut lui sembler constituer une menace, soit parce qu’elle pourrait désirer prendre sa place, soit parce qu’elle pourrait inciter les suiveurs à ne plus lui obéir.
Cependant, un meneur a aussi besoin des autonomes pour pouvoir avancer avec le groupe en ayant à disposition un minimum d’informations et donc d’assurance. Ceux-là peuvent même l’aider à renforcer son pouvoir dans certains cas. Si je reprends l’exemple de mon train, le chef de bord va décider où le train va aller et quand mais il va tout de même suivre un tracé de rails préexistant. Ce tracé de rails, qui est en fait une métaphore désignant des espaces gagnés sur l’inconnu, a été rendu possible justement parce que des personnes autonomes ont eu envie d’aller voir par-ci ou par-là ce qu’il y avait et ont trouvé intéressant d’y poser des rails, parfois avec l’aide du reste du groupe d’ailleurs mais pas avant qu’ils n’aient été eux-mêmes explorer la zone en tout premier lieu. Ces espaces inconnus, seuls les autonomes peuvent s’y rendre, car cela ne vient pas à l’esprit des autres profils de le faire.
Si les autonomes n’existaient pas, le train risquerait de foncer vers un désastre en avançant pour ainsi dire à l’aveugle et il est même plutôt probable que le chef de bord décide de rester sur place pour ne pas prendre de risques, ce qui, dans la réalité, n’est pas toujours possible. Les autonomes sont aussi ceux qui vont pouvoir inventer de nouvelles technologies pour le train, de nouveaux outils, plus pratiques, plus efficaces, des sièges plus confortables, etc.
On retrouve ces archétypes dans la façon dont les potentats de l’Histoire s’entourent de conseillers, de savants, d’inventeurs, etc. Tous ces profils sont majoritairement autonomes et entretiennent des rapports complexes avec le ou les meneurs qui les encadrent tant bien que mal. Ils peuvent voir en eux un moyen d’arriver à leurs fins, notamment par du mécénat ou des autorisations de s’adonner à telle ou telle activité ou tel ou tel projet. Mais il arrive aussi qu’ils les détestent, car ils peuvent se sentir menacés par leur volonté de contrôle ou estimer que leur exercice du pouvoir est mauvais. Il arrive aussi qu’ils les ignorent tout simplement.
Vis-à-vis des suiveurs, les autonomes ont tendance à les mépriser, comme je le disais, ou bien à projeter sur eux leur propre caractère autonome, c’est assez fréquent et décevant pour eux et c’est toujours violent pour les suiveurs. Les autonomes ont aussi souvent tendance à les ignorer.
Les meneurs, quant à eux, balancent entre amour et haine à l’égard des suiveurs. Ils peuvent aussi parfois les mépriser, comme c’est courant de nos jours, le mépris et l’indifférence étant les sentiments les plus répandus dans une société individualiste.
L’amour des meneurs pour leur groupe vient du fait que ce dernier est pour eux une raison de vivre très importante. Leur haine vient aussi de la déception que le groupe peut parfois leur inspirer lorsque celui ne se comporte pas comme espéré. En effet, un meneur ne fait pas exactement ce qu’il veut de son groupe, car ce dernier possède des limites dans ses capacités physiques et psychiques. Il peut arriver que le groupe mésentende ce que son meneur lui commande, en en faisant pas assez ou alors beaucoup trop. C’est le cas dans certaines exactions populaires, où les suiveurs dépassent les bornes fixées par leur meneur sans s’en rendre compte, parce qu’ils estiment que leur action est légitime compte tenu de ce qu’ils comprennent des règles en vigueur.
Ces exactions sont aussi permises par la dilution du sentiment de responsabilité dans la masse du groupe. Mon article suivant traitera justement en partie de ce sujet.
En retour, les suiveurs peuvent littéralement adorer leur meneur et lui offrir beaucoup. Ils ont très souvent envie de lui plaire, ce qui passe parfois pour de l’obséquiosité alors qu’il s’agit d’abord d’une validation de la structure sociale à des fins de réassurance.
Mais les suiveurs ont aussi vis-à-vis de leur meneur des exigences, parfois grandes, qui vont de pair avec le fait qu’ils aient remis entre ses mains la responsabilité de guider le groupe. Un meneur qui maltraite son groupe risque gros car, pour peu qu’un meneur potentiel de remplacement se présente, le groupe pourra choisir ce nouveau meneur et se débarrasser de l’ancien, souvent de façon expéditive et cruelle.
Les trois caractères que je décris ici donnent lieu à des profils très reconnaissables dans la société.
Les autonomes sont souvent des scientifiques, des artistes, des explorateurs, des philosophes, des professeurs, des conférenciers, des artisans, des sportifs de haut niveau, des médecins, des commerciaux, des financiers, des moines mais aussi des hors-la-loi ou des psychopathes. Professionnellement, ils choisissent des postes à grande autonomie ou bien créent leur propre entreprise, très souvent unipersonnelle.
Je parle ici des véritables profils et non ceux qui en arborent les atours sans en avoir l’équivalence en termes de compétence. En effet, de nos jours, il existe de très nombreuses personnes qui “font de la science” mais ne sont pas des scientifiques à proprement parler, elles ne font qu’appliquer des protocoles établis par d’autres et ne comprennent que très vaguement ce qu’elles font.
Les meneurs sont des représentants politiques ou syndicaux, des chefs d’entreprise, des directeurs, des responsables, des commandants, etc. Tous les postes où ils pourront exercer une autorité les attireront. On les trouve aussi au niveau familial sous la forme d’un patriarche ou d’une matriarche.
Enfin les suiveurs forment… tout le reste. C’est pour cette raison qu’il est au final très destructeur de se battre contre cette structure naturelle de tout groupe social (animal et humain) car c’est une structure indispensable au groupe lui-même et je pense pour ma part qu’elle est immuable.
Il semble par ailleurs que la dispersion caractérielle que chacun de nous possède ne change pas au cours de la vie mais seulement en fonction des contextes. Je n’en ai pas de certitude mais on peut tout de même observer des tempéraments se dessiner très jeunes chez les enfants quant à leur tendance à plutôt dominer, suivre ou être autonome dans un groupe. Il semble que cela en reste ainsi pour toute notre vie. Par contre, puisque nous vivons des contextes très variables, nous exprimerons à coup sûr au cours de notre vie les trois facettes d’une manière ou d’une autre.
Aussi, il ne faut pas se laisser endormir par les philosophies qui présentent l’accomplissement de l’être comme l’équivalent d’une soumission totale à Dieu ou bien comme l’achèvement absolu du caractère autonome. Ces idées ne correspondent à aucune réalité terrestre et ne sont pas fonctionnelles en société. Il s’agit de théories spéculatives servant à justifier des modèles dogmatiques par ailleurs perclus de contradictions.
J’ajoute pour terminer que ces trois rôles peuvent être endossés indifféremment par des hommes ou des femmes. Cependant, les contextes dans lesquels cela se produit et la façon dont les rôles s’incarnent diffèrent entre les deux sexes.
Par leur caractère exclusivement matriciel, les femmes cherchent à consommer le monde et peuvent participer dans une certaine mesure à sa manifestation. Leur existence inspire aussi des hommes.
Dans leur version dominatrice, les femmes tendent toujours à mettre en place le culte de leur personne et à réduire les autres en esclavage chaque fois que c’est possible. C’est une façon de faire univoque qui provient de la combinaison de leur dynamique narcissique centripète et de leur caractère dominateur. Il n’existe pas de domination autre que celle-ci chez les femmes.
Lorsque leur caractère principal est de suivre, les femmes adoptent les désirs majoritaires, c’est-à-dire ceux des autres et ceux que l’esprit dominant leur suggère ou leur demande. Elles sont en cela extrêmement conformistes et, puisqu’elles ne peuvent trouver de sens qu’à travers des exemples concrets, leur mimétisme est parfois si fort qu’elles semblent toutes disposer de la même personnalité, être faites du même moule.
Les femmes autonomes enfin montrent une autonomie dans le fait de nourrir des désirs qui ne sont pas nécessairement identiques à la majorité du groupe. Cependant, il reste indispensable pour elles de pouvoir entrevoir un minimum l’existence de quelque chose pour le désirer. Puisqu’elles ne disposent pas de dimension essentielle, elles ont besoin, comme toutes les femmes, de trouver leur inspiration à l’extérieur d’elles-mêmes. Par ailleurs, ce profil de femmes autonomes est le plus indiqué parmi la gent féminine pour pouvoir accompagner dans sa manifestation des hommes eux-mêmes autonomes.
Ces derniers sont d’ailleurs l’un des profils les plus typés puisque la combinaison de l’autonomie et de la nature masculine produit les seules personnes capables de faire évoluer un groupe en apportant de la nouveauté : des inventions et des innovations. Ces profils ne sont pas tous remarquables mais les plus remarquables des profils sont tous des hommes autonomes (y compris lorsqu’il s’agit de meneurs hors du commun, car ceux-ci disposent manifestement tous d’une dimension autonome prononcée, les meneurs peu autonomes sont généralement assez ordinaires, ils dirigent mais ne se démarquent pas particulièrement des autres meneurs). On trouve aussi dans ce profil d’hommes autonomes les personnes les plus solitaires et les plus iconoclastes.
Les hommes dominants, quant à eux, peuvent exprimer une volonté de pouvoir pour deux raisons principales : projeter leur égo ou projeter autre chose.
Dans le premier cas, très courant à notre époque dans les couches intermédiaires de pouvoir, ces hommes vont développer un tempérament dominant assez proche de celui des femmes dominatrices. Mais puisque, à la différence de ces dernières, ils disposent d’une dimension essentielle, leur capacité de manœuvre peut prendre des ampleurs bien plus vastes et plus complexes et leur volonté de parvenir à leurs fins peut dépasser leur peur de la mort et du rejet. Ces deux aspects rendent ainsi les hommes bien plus capables que les femmes en termes de domination quand cette dernière se rapporte à des groupes humains un tant soit peu important (plus d’une vingtaine de personnes environ, au doigt mouillé).
En effet, lorsqu’une femme, même dominatrice, rencontre un dominant masculin d’une ampleur au moins aussi grande, sa peur de perdre la possibilité de consommer le monde comme elle le souhaite prend généralement le dessus sur sa volonté de dominer et elle aura davantage tendance à chercher la négociation et même la soumission, notamment parce qu’un homme est physiquement plus fort, mais aussi parce qu’un homme dominant est capable de déployer une force mentale à toute épreuve et est prêt à prendre tous les risques pour arriver à ses fins, ce qui n’est pas le cas des femmes, qui cherchent avant tout à préserver leur capacité à consommer les choses et donc leur vie (instinct de sécurité typiquement matriciel).
Cette forte volonté d’accéder au pouvoir et d’avoir les moyens de le faire se retrouve tout autant chez les hommes dominants qui ne sont pas égoïstes, à la différence près que chez ces derniers, leur engagement ne les concerne pas eux directement, en tant qu’individus, mais le ou les projets qu’ils portent. En cela, ce sont les seuls dominants capables de proposer un projet d’ampleur pour un groupe et notamment des idées qui sont censées perdurer des siècles. Leur projet de domination est ainsi un moyen pour une fin et non une fin en soi. Ce sont, avec certains hommes autonomes non égoïstes, les plus idéalistes des personnes. Ils se sacrifient spontanément pour leur projet.
À notre époque, ce profil est encore assez présent mais partiellement noyé dans la masse des dominants, hommes et femmes, qui n’œuvrent que pour eux-mêmes. Les deux types se retrouvent d’ailleurs à tous les étages de la hiérarchie, même mondiale, et leur nature se devinent à travers leurs choix et leurs projets. On voit chez les seconds un réflexe permanent de conservation et d’extension du pouvoir tandis que les premiers cherchent vraisemblablement à appliquer sur les groupes humains des intentions qui ne sont pas uniquement dédiées à leur arrivisme. Du reste, lorsque l’on monte suffisamment haut dans les hiérarchies humaines (les hiérarchies réelles, pas celles d’apparat), on ne trouve plus aucune femme, pour les raisons déjà évoquées.
Cependant, lorsque l’on ne dépasse pas un petite nombre de personnes, les femmes dominatrices sont très capables d’assurer leur domination et le cas le plus flagrant est celui du couple. C’est d’ailleurs le contexte où le tempérament dominateur des femmes s’exprime le plus systématiquement de façon générale, peu importe qu’elles aient par ailleurs un tempérament autonome ou suiveur dans des contextes plus larges.
Ce phénomène est assez simple à comprendre si l’on se remémore le fait que la capacité de compréhension des femmes est réduite à ce qu’elles perçoivent directement et donc à leur environnement direct. Leur caractère narcissique centripète les empêche de bien voir au-delà et les plus puissantes des matriarches ne parviennent à créer et diriger que des cercles d’influence très réduits, comme on peut le voir dans les sociétés traditionnellement matriarcales.
Cependant, pour beaucoup de femmes, leur volonté de domination sur leur environnement direct est très fort et induit de nombreux comportements typiques que j’aurai l’occasion d’aborder plus tard. Dans le cas du couple, cette volonté s’exprime donc très nettement et il faut un homme particulièrement dominant et rassurant pour l’équilibrer ou la contrecarrer. Il est d’ailleurs fréquent d’observer des couples où les hommes sont soumis au foyer mais dominants en dehors du foyer tant ce contexte met en évidence la volonté de domination des femmes, qui est un prolongement naturel de leur instinct de consommation, cherchant à s’assouvir de gré ou de force.
Enfin, les hommes suiveurs ont un profil assez particulier. Tout d’abord, ils mettent spontanément leur existence au service de l’une des causes dominantes et sont parfois prêts à y laisser la vie. Leur dimension essentielle répond aux injonctions du groupe en introjectant ces dernières et les messages qu’elle véhicule. En cela, les hommes suiveurs peuvent se faire d’excellents relais de la pensée dominante, de façon articulée et même parfois complètement maîtrisée. Ils peuvent même le faire avec une énergie et une patience infinies car il n’y a généralement que très peu de place au doute chez eux.
La différence entre les hommes suiveurs et les femmes suiveuses réside tout simplement dans la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes suiveurs seront capables de comprendre fondamentalement ce qui est attendu d’eux et seront prêts à se sacrifier pour le permettre d’advenir, là où les femmes sont uniquement focalisées sur ce qu’un projet peut leur apporter en termes de consommation, projet pour lequel elles pourront consacrer du temps si besoin mais ne se sacrifieraient pour rien au monde.
Tous ces éléments sociaux de base sont simples mais leurs implications dans la réalité des dynamiques humaines peuvent être complexes et subtiles. J’aurai l’occasion de les aborder à de nombreux reprises par la suite car ils déterminent des comportements typiques qui sont faciles à expliquer à partir de la nomenclature que je viens de présenter.