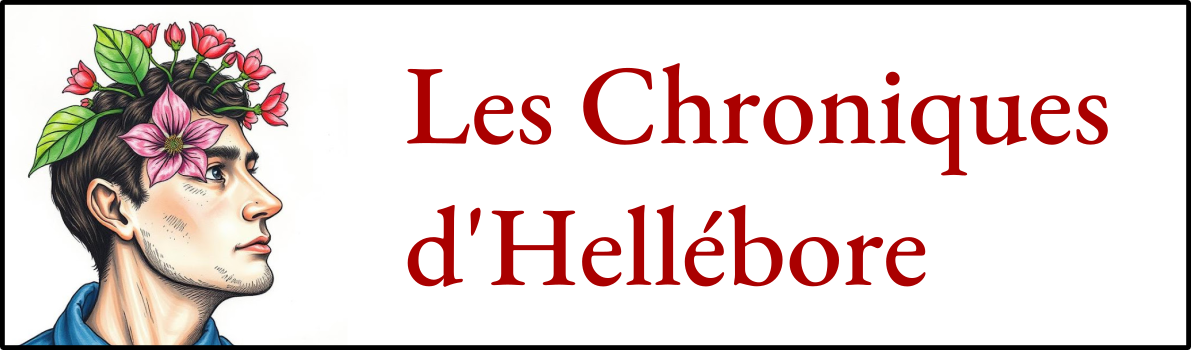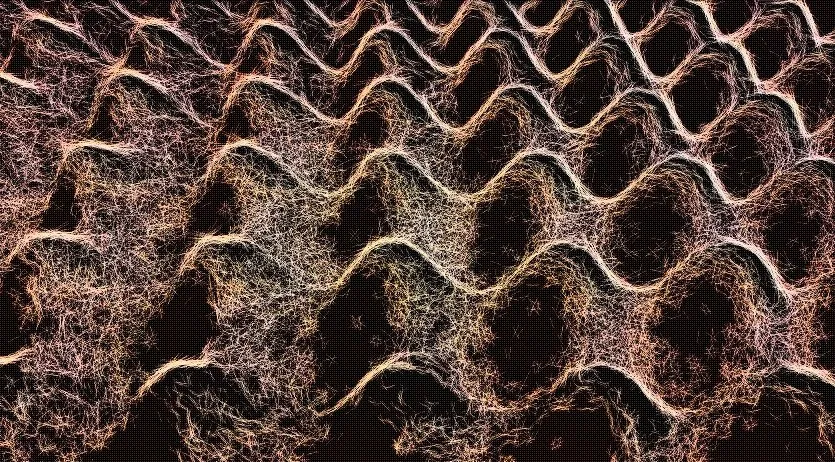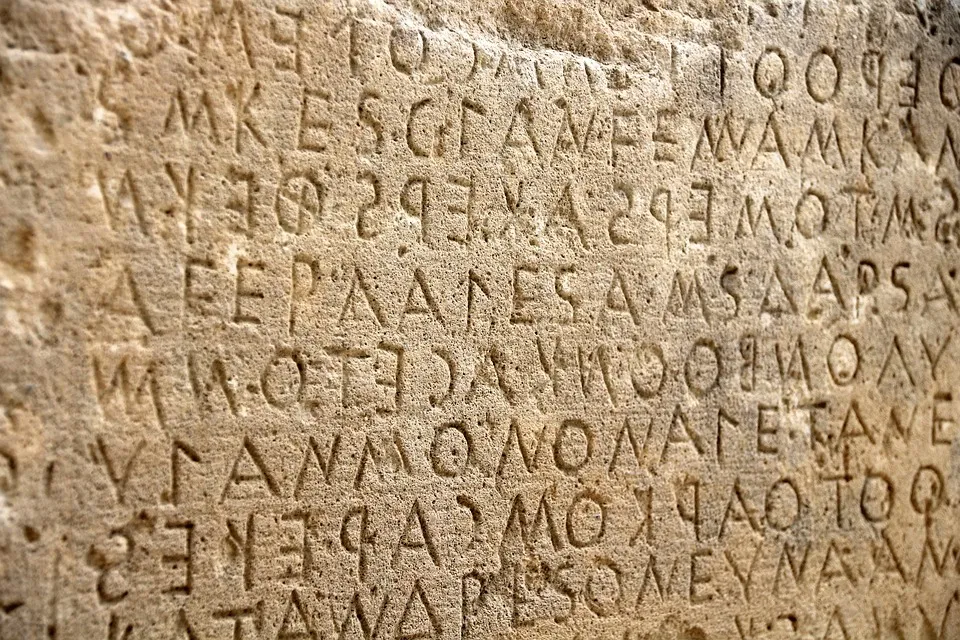L’art de la méthode logique
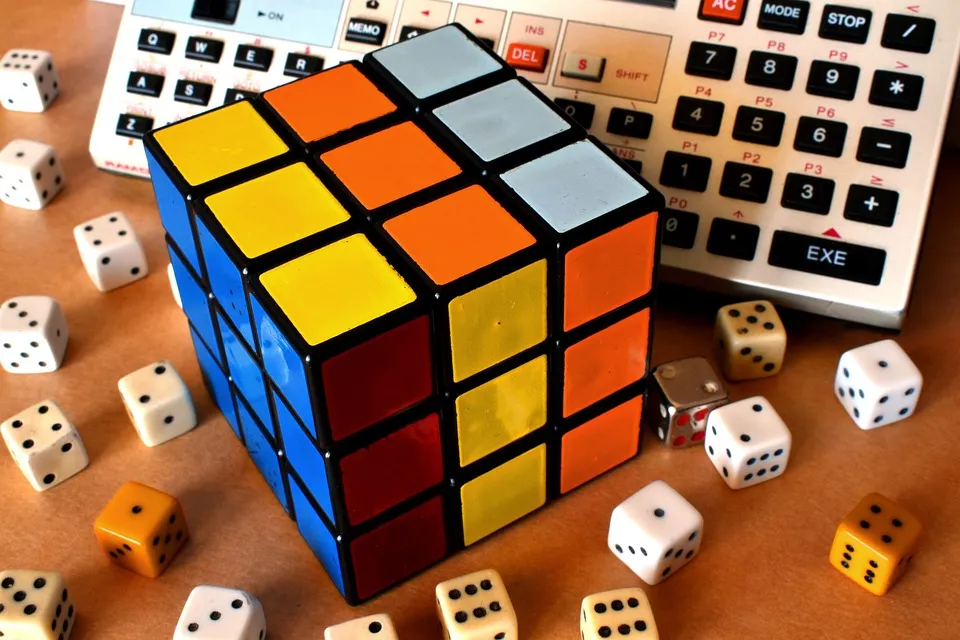
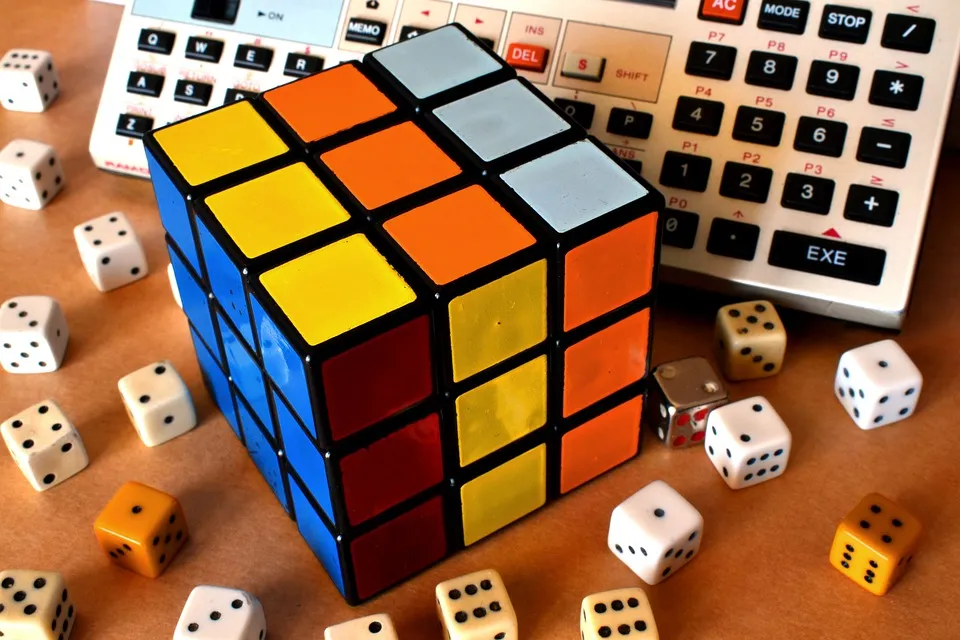
Toujours dans l’optique d’une compréhension saine et rationnelle de la réalité, il convient de ne pas mélanger les genres lorsque l’on emploie des méthodes d’analyse logique.
La raison à cela est qu’il existe plusieurs façons de procéder pour apprendre à connaître le réel et qu’elles ne devraient théoriquement pas être confondues.
En effet, de nombreuses erreurs d’analyse proviennent du fait que les méthodes à notre disposition sont mal employées. C’est le cas, par exemple, lorsque l’on use de la méthode philosophique pour faire de la science ou lorsque l’on emploie la méthode scientifique pour avancer sur un sujet philosophique. Dans les deux cas, non seulement nous nous heurtons rapidement à des erreurs et des impasses mais cela rend impossible le dialogue avec les personnes qui emploient correctement les méthodes correspondantes (quant à celles qui commettraient les mêmes erreurs, échanger avec elles aurait certainement tendance à nous enfoncer dans nos propres égarements).
L’usage d’une méthode censée nous faire progresser dans nos connaissances du monde se résume toujours à sa capacité à anticiper les évènements. Plus nous sommes exacts dans nos prédictions, plus cela signifie que notre connaissance est véritable et corrélée à la réalité.
Cependant, la nature même des éléments considérés ne nous permet pas d’employer n’importe quelle méthode et le but de cet article est précisément de rappeler à quoi s’adressent les méthodes que je vais présenter : la méthode scientifique, la méthode philosophique et la méthode intuitive.
Petite précision avant de poursuivre au sujet de ces trois méthodes : il est couramment admis que le partage des éléments de connaissance à la collectivité améliore les chances de progresser sur le chemin de la vérité.
Si cela permet de limiter l’autovalidation injustifiée de certaines certitudes (biais de confirmation, absence de remise en question), cela ne garantit pas en réalité de déboucher sur une meilleure compréhension du réel.
En effet, l’application collective à la connaissance n’a pas de caractère particulièrement supérieur ou inférieur à l’application individuelle : il est tout fait possible d’avoir tort à plusieurs et raison tout seul. Les effets grégaires consubstantiels aux dynamiques de groupe peuvent tout à fait s’opposer frontalement à la vérité et le caractère autonome de certains individus se faire particulièrement lucide quant au monde tel qu’il est.
Il n’en demeure pas moins que le partage peut aider sur certains points, comme ceux évoqués juste avant, et il n’est donc pas spécialement préférable de garder ses découvertes pour soi si l’on estime justifié que d’autres que nous mettent à l’épreuve nos idées. D’ailleurs, pour peu que l’on parvienne en toutes circonstances à garder sa propre autonomie psychique (ce qui nécessite obligatoirement un tempérament particulièrement autonome), il demeure possible de considérer les avis des autres de façon rationnelle également et de les rejeter s’il s’avère qu’ils sont ineptes.
Pour ma part, la mise à l’épreuve de mes idées par d’autres personnes me paraît globalement peu pertinente. Cela provient du fait que j’estime la plupart des gens comme incapables de raisonner correctement et les échanges éventuels qui peuvent survenir avec eux m’apparaissent presque toujours comme une énorme perte de temps.
Du reste, il peut arriver exceptionnellement qu’une personne me fasse une remarque pertinente sur mes analyses et c’est l’une des raisons pour lesquelles je persiste à partager mes recherches.
Ceci étant dit, voyons maintenant les trois méthodes à notre disposition et à quoi elles servent exactement.
La méthode scientifique
Commençons par la méthode la plus connue, celle qui est dite scientifique. Celle-ci, changeante à travers l’Histoire pour diverses raisons (évolutions des connaissances et des idéologies), s’adresse à la réalité tangible, c’est-à-dire, avant tout, aux formes.
En cela, la méthode scientifique s’appuie sur du concret, fut-il parfois aussi subtil qu’un champ magnétique : ce que l’on étudie et analyse doit être identifiable et mesurable (qualifiable et quantifiable), il doit comporter des caractéristiques physiques, il doit être observable de façon répétée.
La méthode scientifique nous sert à tester concrètement par des expériences la solidité de nos hypothèses pour en élaborer des théories, toujours ouvertes à la critique, ce qui peut conduire dans le meilleur des cas à leur amélioration (élaboration d’une version améliorée de la théorie pour décrire la réalité) ou à leur rejet justifié (découverte d’une autre théorie, meilleure dans la description de la réalité).
Ces théories sont en fait des traductions des principes sous-jacents à la réalité (que je nomme souvent essences ou principe essentiel dans mes articles) : il s’agit de dégager des observations du monde des lois, des règles, des logiques qui se vérifient à volonté.
Bien sûr, puisque le chemin de la vérité est infini, il est toujours possible d’affiner les modèles élaborés à partir de la méthode scientifique et l’activité scientifique en elle-même est potentiellement éternelle.
En outre, la méthode scientifique aide à mettre au point des protocoles qui peuvent être employés pour des milliers des choses et mis en œuvre par des personnes qui, éventuellement, n’auraient aucune connaissance du sujet abordé. Si l’on applique à la lettre un protocole de chimie dont la théorie sous-jacente est correcte, que celui-ci soit réalisé par un expert chimiste ou un percepteur d’impôts, cela ne change rien au phénomène qui va se dérouler.
Cette caractéristique peut exister dans les deux autres méthodes mais les protocoles afférents y seront le plus souvent beaucoup moins précis et définis. On sait mesurer le volume d’une carafe d’eau mais on ne sait pas mesurer le volume d’un doute ou la volatilité d’un humour, du moins, pas en l’état actuel de nos connaissances.
Aussi, et c’est important, la science est toujours descriptive, elle n’est jamais prescriptive. S’il est possible de trouver des philosophies et des intuitions strictement descriptives, force est de constater que ces deux méthodes intègrent aussi beaucoup de travaux prescriptifs, c’est-à-dire relevant de ce qui est bon et juste. La science, elle, ne s’intéresse pas à ces questions, tout au mieux peut-elle aider les humains à débattre des sujets du bien et du mal mais elle en demeure étrangère elle-même. Son rôle est de décrire la réalité, pas de nous indiquer quoi en faire.
Malgré la force de son approche, la méthode scientifique possède une faiblesse importante : elle est incapable d’innover.
En effet, la rigueur d’analyse scientifique n’intègre pas en elle-même la possibilité d’envisager d’autres façons de penser et de faire. Elle se base sur des hypothèses, qu’elle teste, mais elle ne les formule pas. On ne peut déduire scientifiquement une hypothèse qui n’a jamais été testée, sa source est autre et notamment philosophique et intuitive. Sur ce point, les scientifiques s’appuient sur leurs idées, leurs sentiments ou leurs intuitions. La connaissance par ailleurs de démonstrations scientifiques pourra bien sûr influencer ce processus dans la formulation des hypothèses mais il ne saurait en être à l’origine. La science ne nous permet pas d’ouvrir par elle-même des champs d’études, elle nous aide simplement à vérifier si ce que nous pensons comprendre du monde tient debout ou non.
C’est pour cette raison qu’il est vain de ne s’en tenir qu’à une seule méthode et que les trois sont en réalité complémentaires. Ceci dit, cela ne veut pas dire que l’on peut en user n’importe comment, comme je le disais précédemment. Chacune a son intérêt et sa fonction.
Cette limitation de la méthode scientifique quant à la formulation première des hypothèses est la raison pour laquelle il est exact de considérer la créativité comme une qualité majeure pour faire de la science, pour peu que celle-ci ne s’égare pas dans la pure fantaisie.
La méthode philosophique
La méthode philosophique a pour moi quatre orientations possibles :
son usage permet de produire de nouvelles pistes de réflexion qui peuvent éventuellement favoriser et enrichir la démarche scientifique
elle permet d’aborder des sujets pour lesquels nous n’avons pas la possibilité d’user de la méthode scientifique par impossibilité pratique (trop compliqué à mettre en œuvre)
elle permet d’aborder les sujets inaccessibles à la science parce qu’ils ne se rapportent pas à la réalité tangible
elle est prescriptive, c’est-à-dire qu’elle formule des incitations à faire les choses d’une certaine façon et porte des jugements sur ce que devrait être la réalité
Dans mon travail pour Metalogos, j’use de philosophie pour les deux premières raisons : je m’en sers pour ouvrir des pistes d’étude que je n’ai pas vues abordées par ailleurs et les sujets qui m’intéressent sont le plus souvent si difficiles à approcher par la méthode expérimentale scientifique seule que je m’adonne principalement à la réflexion théorique, en prenant soin de ne pas en faire n’importe quoi.
Cette dernière approche peut sembler à un pis-aller et c’est le cas : si les sujets que je traite et les hypothèses que je propose pouvaient être directement testés scientifiquement, je privilégierai la méthode scientifique sur ce point (confirmer ou infirmer mes hypothèses).
Sur ce point, si d’aventure la science apporte des éléments connexes à l’étude philosophique produite, ils pourront être immédiatement assimilés et, dans tous les cas, pour peu que la démarche soit sérieuse, devraient l’être.
C’est personnellement ce que je fais pour tous les sujets que j’aborde : je ne cesse de les tester par l’observation et si je trouve un article scientifique en lien avec le sujet en question, je m’applique à vérifier s’il corrobore mes dires ou s’il les infirme tout en prenant bien soin d’évaluer la qualité du travail lui-même qui est, soyons honnête, très souvent mauvais (j’y reviendrai dans d’autres articles).
On peut donc imaginer qu’un jour la méthode scientifique parvienne à tester par l’expérience des théories philosophiques jusqu’à présent inaccessibles à la science tel que le sens de la vie ou l’addiction au pouvoir. Cela n’est pas exclu et serait même en fait une bonne nouvelle pour la recherche de la vérité.
La troisième approche philosophique de la liste, à laquelle je me refuse personnellement pour des questions de temps et de goût du réel est celle qui consiste à produire des éléments de pensée abstraits, parfois très éloignés de la réalité quand ils ne sont pas clairement faux, pour la simple raison que la démonstration employée est correcte (respect des principes logiques).
La philosophie moderne autorise cette façon de faire car elle n’intègre pas nécessairement dans sa méthode le principe de vraisemblance et notamment la vérification matérielle des dires. Sur ce point, la philosophie peut tout à fait conserver son caractère logique (l’enchaînement de propositions et de déductions rigoureusement corrélées) mais elle néglige en fait la contrainte tangible des axiomes (une contrainte qui existe en revanche en science). Cela signifie que je peux tout à fait philosopher rigoureusement à partir d’inepties. Rien ne m’empêche de partir d’un constat de base délirant pour ensuite en dérouler une démonstration qui est en elle-même rigoureusement logique.
C’est d’ailleurs une façon de procéder fréquente qui peut être considérée comme fallacieuse. Elle est cousine de l’hypothèse ad hoc qui consiste à ajouter des explications surnuméraires et injustifiées à une théorie pour éviter sa réfutation. Ici, les hypothèses ne sont pas surnuméraires mais bel et bien au cœur de la démonstration de base, on pourrait parler d’axiomatique ad hoc et cela cache généralement une volonté d’arriver à une certaine conclusion, déjà formulée par avance.
Cette porte ouverte me semble causer un certain tort à la philosophie et favoriser dans ce domaine les impostures. Il suffit de lire le premier chapitre du Capital de Karl Marx pour comprendre que l’on peut élaborer à l’envi des axiomes incorrects sur lesquels appuyer ses démonstrations et prétendre ensuite qu’il s’agit d’une activité philosophique digne de ce nom.
La vérification de la vraisemblance des axiomes et des hypothèses de base me semble être nécessaire à toute démarche saine de pensée et ferait sans doute le plus grand bien à la philosophie, qui s’attache parfois à mon sens plus à sa logique interne qu’aux sujets qu’elle aborde.
Enfin, la quatrième et dernière approche, prescriptive, est pour moi tendancieuse du fait qu’elle mêle en réalité philosophie et politique : voilà ce qui est vrai, voilà ce qu’il faut faire. On ne peut nier que l’histoire de la philosophie est truffée d’idées prescriptives et il semble assez humain de projeter dans ses travaux de connaissance ses propres valeurs. Cependant, pour des raisons de clarté, il me semble préférable de distinguer les deux procédés. Je ne dis pas qu’ils ne peuvent cohabiter (je me laisse moi-même parfois tenté par des incitations, comme je viens de le faire au paragraphe précédent) mais qu’ils sont souvent confondus et l’espoir renouvelé de nombreuses personnes de faire surgir des notions prescriptives à partir des travaux de connaissance (scientifiques ou philosophiques) m’apparaît comme contre-productif (une tendance que l’on observe principalement dans les contextes religieux).
À des fins de rigueur, il me semble au contraire préférable de ne laisser aucune ambiguïté entre les explications philosophiques descriptives et les incises à caractère politique. C’est d’ailleurs pour cette raison que je n’emploie le terme de philosophie que dans son sens descriptif et garde le vocable de politique pour toute injonction de nature prescriptive.
À savoir également que la mathématique est en réalité une branche de la philosophie descriptive possédant son propre langage, et non une science. En effet, elle possède les mêmes caractéristiques que la philosophie descriptive : elle peut tout aussi bien être utilisée sur des sujets tangibles et vérifiables que dans des contextes artificiels élaborés pour le plaisir de la démonstration. En cela, la mathématique, comme la philosophie, permet tout et n’importe quoi et c’est la méthode scientifique qui peut aider à faire en sorte qu’elle soit utilisée dans un contexte réel ou tout du moins réaliste.
Tout ceci étant dit, j’admets la possibilité qu’un usage irrationnel de la philosophie ou de la mathématique puisse déboucher sur des applications rationnelles. C’est le cas par exemple avec la théorie des ensembles et pour reprendre le cas de Marx, il est entendu que ses écrits ont pu aider d’autres personnes à aborder les sujets qu’il évoquait, même s’il se trompait sur certaines de ses déductions.
Il est cependant indispensable de comprendre précisément où l’on se situe pour évaluer la pertinence des méthodes et des travaux et ne pas perdre de vue que l’emploi d’axiomes ad hoc sans grande pertinence est extrêmement fréquent en philosophie.
La méthode intuitive
Finissons avec la méthode la plus controversée, que certains rejettent d’ailleurs complètement.
L’intuition est une capacité de l’être humain à produire de la connaissance sans que le processus qui permette d’y parvenir soit connu. Dans ce domaine, tout le monde n’est pas d’accord. Certains pensent que l’intuition permet d’aller « chercher » des informations où elles sont et d’en retirer une idée intelligible, d’autres considèrent qu’il s’agit simplement de déductions qui se produisent au niveau inconscient et dont seul se présente à la conscience la conclusion proprement dite.
On peut y voir aussi de l’instinct et nous avons tous déjà été sujets à ce type de phénomène où, par exemple, nous ne « sentons » pas quelqu’un sans pour autant être capable de l’expliquer.
J’estime pour ma part que l’intuition est la traduction d’une analyse inconsciente qui donne lieu à une déduction suffisamment importante pour que celle-ci remonte en quelque sorte à la conscience.
Le fait par exemple d’être à même de sentir un danger sans nécessairement être capable de l’expliquer semble être une capacité importante en termes de survie. Le fait que nous puissions nous méfier de quelqu’un provient possiblement d’un ensemble de signaux que nous percevons inconsciemment (langage corporel, intonation de la voix ou autre) mais qui sont peut-être trop nombreux ou trop subtils pour que nous en ayons parfaitement conscience. Nous sentons juste qu’il ne faut pas faire confiance à cette personne.
Là où il peut cependant y avoir en véritable débat, que j’estime pour ma part extrêmement pertinent, est la source même des informations de base qui permettent de générer en nous une intuition.
En effet, on peut considérer l’intuition telle que je la décris ici et s’en tenir à des stimuli matériels facilement identifiables et même connus et étudiés par la science. En cela, l’intuition, instinct ou sixième sens, se réfère à des éléments directs de notre environnement perçus par nos cinq sens et analysés ensuite par notre cerveau.
Cependant, l’intuition est un mot qui est aussi employé dans des contextes mystiques ou magiques. Dans ces domaines, l’intuition peut même se rapprocher parfois de l’omniscience et s’apparente à une capacité extralucide pluripotentielle, utilisable pour n’importe quoi et capable de choses véritablement extraordinaires.
Si je n’avais vécu à plusieurs reprises des évènements véritablement surprenants où les personnes concernées, y compris moi-même, ont pu faire montre d’une capacité à découvrir des informations apparemment impossibles à deviner par ailleurs et dont la probabilité de simples coup de chance semble réellement proche de zéro, la première explication m’aurait sans doute parut suffisante.
Cependant, je ne peux décemment à ce jour m’en tenir à cette vision strictement sensorielle des sources d’information captée et analysée inconsciemment par notre cerveau. Je considère tout à fait possible que l’être humain ait des capacités inconnues à ce jour par la science et qui concernent des phénomènes télépathiques, « télécognitifs » et divinatoires.
Il convient néanmoins de ne pas tout mélanger et je considère en revanche également très fréquent la considération extralucide d’intuitions en réalité parfaitement explicables de façon terre-à-terre. On le voit par exemple avec les spectacles de mentalistes, qui apprennent à conscientiser des signaux corporels spontanés que nous captons presque tous inconsciemment.
Certaines personnes usent de leur intuition dans des contextes professionnels comme les médiums, les thérapeutes, les guides spirituels et autres. Si certains ont possiblement des capacités psychiques extraordinaires, il est aussi réel que nombre d’entre eux prétendent détenir des pouvoirs en réalité inexistants et ce, en étant persuadés eux-mêmes de leur aptitudes.
Il y a donc, dans ce domaine, beaucoup de pistes à explorer et de phénomènes à clarifier.
En cela, la méthode intuitive est recevable (et nous nous en servons tous les jours) mais du fait de son caractère mystérieux (processus non conscients), il convient d’être prudent quant à ce que l’on estime être la source de nos informations (pour peu que cela nous intéresse bien évidemment).
Chaque fois que c’est possible, il sera, je pense, de bon aloi d’user de méthodes compatibles avec la démarche scientifique pour valider ou non nos intuitions, pour peu que l’on accorde de la valeur au fait de progresser sur le chemin de la vérité.
Par ailleurs, l’intuition peut tout à fait servir la science et c’est d’ailleurs ce que font les scientifiques depuis toujours : formuler des hypothèses pressenties et les tester rigoureusement. D’ailleurs, le fait que de nombreuses hypothèses formulées de cette façon s’avèrent être erronées montre bien que l’intuition est loin d’être un phénomène infaillible. Cela peut néanmoins être une source de découvertes et d’inventions et on peut donc y voir une aptitude complémentaire à la science.
En conclusion, les trois méthodes (scientifique, philosophique et intuitive) sont des méthodes recevables d’accès à la connaissance (je les emploie d’ailleurs toutes les trois pour rédiger mes articles). Elles ne sont pas interchangeables mais complémentaires et s’élaborent à partir d’objets parfois très différents (un phénomène physique mesurable, une idée abstraite, une information d’origine inconnue). Toutes les trois ont des forces et des faiblesses et aucune ne se suffit à elle-même. Il est d’ailleurs efficace en termes de recherche de vérité de vérifier la cohérence des trois méthodes sur un seul et même sujet. Si au moins l’une des méthodes contredit les autres, c’est qu’il se trouve un problème logique quelque part.
Du reste, c’est aussi la façon dont les humains parviennent à appliquer rigoureusement ou non ces méthodes qui va déterminer la qualité des conclusions. Inutile en effet de s’adonner intensivement à la science, la philosophie ou l’intuition si nous ne sommes pas capables de le faire de manière exacte et cohérente.
Ce dernier problème sera d’ailleurs à l’origine de futurs articles car il est bien plus pertinent de critiquer les méthodes que les conclusions lorsqu’il s’agit de rétablir la vérité ou tout du moins d’orienter les études vers une façon de faire plus rigoureuse.