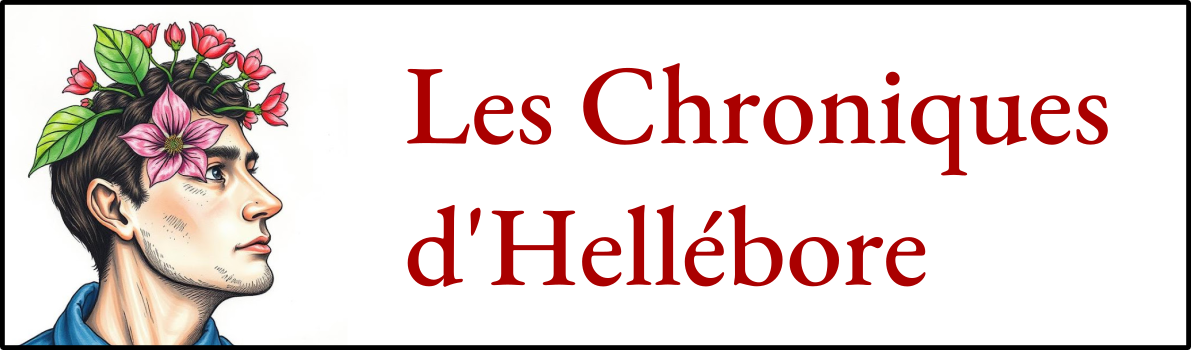La dualité primordiale
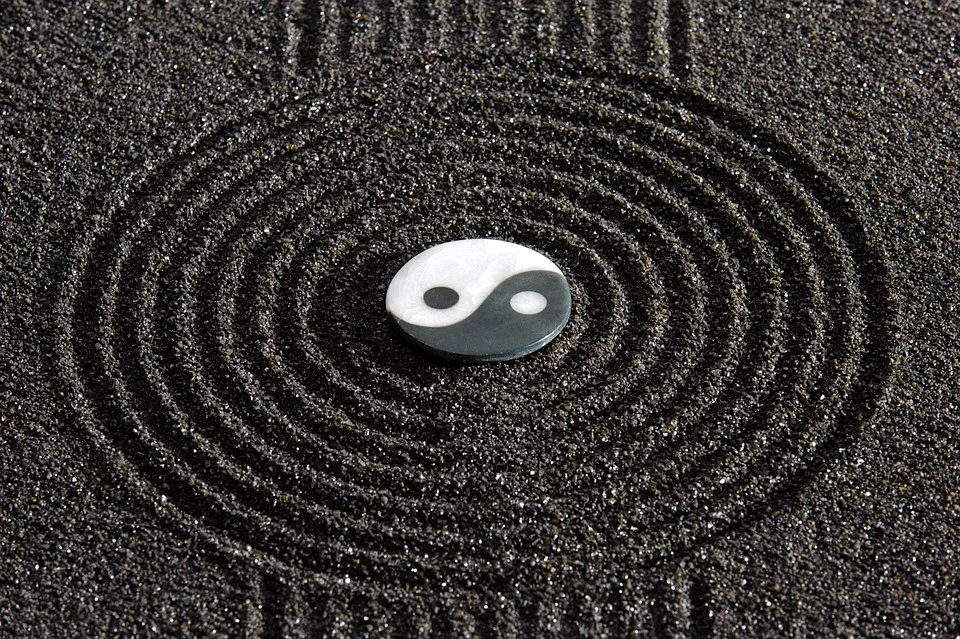
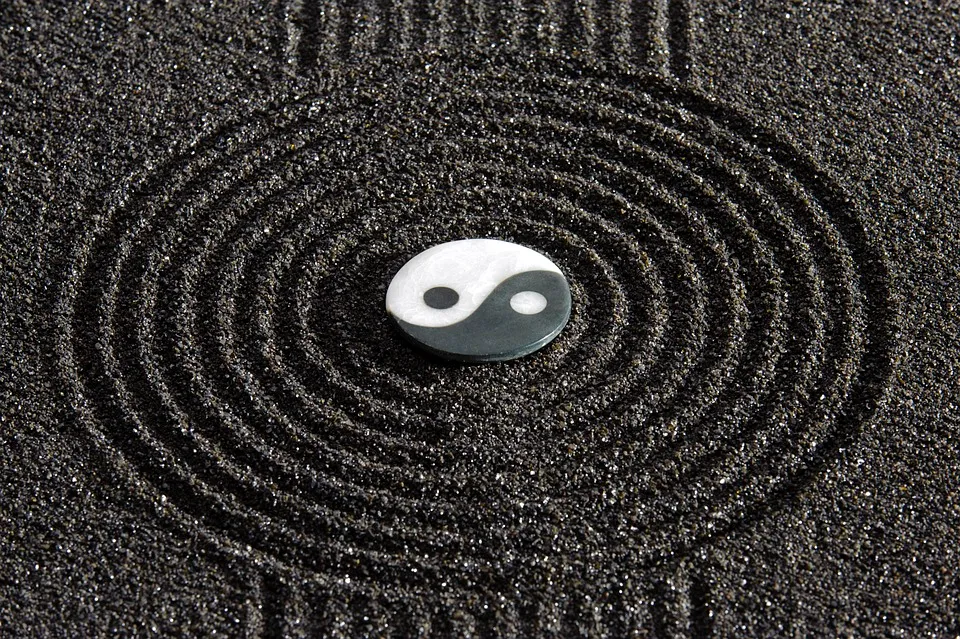
Où que l’on regarde, quoique l’on évoque, la réalité ne fait que nous apparaître comme un ensemble de formes (une montagne, un arbre, un cheval, etc.) coexistantes (coexistence permise par l'existence d'au moins un point commun entre toutes ces formes).
Cependant, si ces formes multiples et polymorphes sont indéniables, nous sommes également capables de remarquer des similitudes entre elles. En effet, une montagne est dite "montagne" de façon générique. Si nous n'avions pas de notion pour exprimer cette identité, nous n'aurions simplement pas pu la nommer. Ce que nous aurions devant nous serait une forme à laquelle nous aurions pu donner une terminologie spécifique (par exemple : les Alpes) mais pas générique, le terme montagne étant né de notre capacité à identifier certains des points communs entre les formes.
Pourtant, pas une montagne n'est strictement identique à une autre, bien que le fait que le terme "montagne" demeure pratique et usité signifie que ce qu'il exprime est bel et bien une réalité observable et reconnaissable.
Notre réalité est ainsi constituée de formes aux expressions infinies qui n'en révèlent pas moins des similitudes dont la structure typique n'apparaît jamais tout à fait (il n'existe pas de référence pure de montagne, d'archétype parfait, seulement une idée qui se dégage des formes réelles).
Cet élément sous-jacent perceptible mais jamais directement observable sera ici appelé essence. Toutes les montagnes du monde émanent de la même essence mais chacune de leur forme est unique. De plus, la démonstration de ces essences est par nature sujette à discussion puisqu'elle s'enracine elle aussi dans un contexte nécessaire. En effet, à partir de quel seuil appelle-t-on une formation rocheuse une montagne et non un mont ou une colline ? La réponse apportée ne pourra jamais être absolue.
Le terme d’essence peut, dans certains contextes, être remplacé par le terme de concept. La différence entre les deux réside dans la façon dont est considéré le phénomène. Dans le premier cas, il est considéré comme élément à part entière du monde réel, dans le second, il est considéré comme symbolisation humaine. Je fais personnellement une différence très nette entre les deux et n’emploie le terme de concept qu’en tant que produit anthropologique là où je considère l’essence comme un phénomène réel au-delà de l’humain.
Maintenant, il est très important de définir les éléments primordiaux qui nous permettraient d'expliquer à eux seuls cette observation d'une irréductible dualité entre les éléments formés uniques et les essences qu'ils suggèrent.
Tout d'abord, nous pouvons poser le principe essentiel comme l'un de ces éléments nécessaires. Ensuite, il serait tentant de dire que les formes elles-mêmes sont le deuxième élément de base mais c'est incorrect, puisque leur existence même nous a permis de conclure à celle des essences et donc, les formes observées possèdent en elles ce principe essentiel. Il serait grossier de définir un deuxième élément primordial en fonction du premier, cela reviendrait à ne pas répondre à la question du tout.
Il y a donc un autre principe, non directement observable lui aussi, qui a pour nature d'amener les essences à se présenter de manière suggérée, non directe mais néanmoins perceptible. Ce principe participe aussi, selon toute vraisemblance, à des expressions infiniment polymorphiques des essences. Cela peut provenir de deux choses :
le principe en question a tendance à occulter les essences et cela soulève immédiatement une autre question : par quoi ces essences seraient-elles alors occultées ?
le principe en question a tendance à combiner les essences entre elles, de sorte que l’observation d’une manifestation tend à toujours être le fruit de multiples essences, empêchant censément toute observation d’une essence pure
Pour décider de l’hypothèse la plus probable, il peut être judicieux ici de considérer la capacité des formes à être plus ou moins fidèles aux essences que l’on reconnaît en elles. L’idée du cercle, par exemple, existe dans notre esprit de façon plus ou moins similaire et ce, dans toutes les cultures du monde.
Si nous sommes mis en face de deux dessins dont l’un est un cercle parfait et l’autre un carré, l’immense majorité d’entre nous choisira le cercle parfait comme représentant le plus fidèle de l’idée du cercle. Une minorité, peut-être, choisira le carré parce que sa perception des formes est différente (littéralement anormale dans cet exemple-ci) ou parce qu’elle aura été tributaire d’une équivoque d’apprentissage quant à la nature du cercle.
Il est donc possible pour les formes réelles de représenter plus ou moins clairement les essences qui participent à leur manifestation et si l’exemple du cercle et du carré est simpliste, il n’en est bien évidemment pas de même pour la réalité tangible où les formes ne sont pas aussi pures mais plutôt des assemblages extrêmement variés de diverses essences que nous reconnaissons tant bien que mal à travers nos réflexions et parmi elles nos sciences. Empiriquement, ces assemblages semblent néanmoins plus ou moins subtils, plus ou moins évidents. Un canard et une loutre sont par exemple faciles à considérer en tant qu’oiseau et mammifère et notamment grâce à l’abondance des manifestations de ces deux essences sur notre Terre, mais un ornithorynque…
L’occultation apparente des essences par les formes qui les représentent concrètement proviendrait donc de leur multiplicité au sein de ces formes et non d’un quelconque phénomène supplémentaire de dissimulation. En effet, si ce dernier était réel, alors nous peinerions à nous figurer des essences de manière pure, mais ce n’est pas le cas, car ce n’est pas tant le degré de pureté des archétypes qui fait parfois défaut à notre pensée mais la certitude que ce que nous avons identifié comme tel est adéquat pour symboliser le réel. Ici, les erreurs ne proviennent pas tant de la pureté des idées que de leur pertinence !
Le second principe qui nous intéresse est donc tout simplement un principe formant. Il permet aux essences de se manifester, de prendre forme : des formes variables et délimitées dans l'espace et le temps mais possiblement renouvelables à l'infini.
Discutons maintenant du rapport à ce temps. En effet, les formes semblent très éphémères en comparaison des essences. Un papillon vit peu de temps mais son essence apparaît, elle, beaucoup plus durable. En fait, elle est potentiellement éternelle, car la combinaison particulière du principe essentiel que requiert son émergence peut potentiellement survenir à nouveau et ce, aussi longtemps que durera la réalité, c’est-à-dire, comme nous l’avons déjà vu : toujours.
Ainsi, si la forme apparaît et disparaît sans cesse, l'essence, elle, demeure, et la réalité conserve alors la capacité de la manifester à nouveau, sous des formes qui ne seront sans doute jamais parfaitement identiques les unes aux autres mais qui comporteront d'une manière ou d'une autre les marques de l'essence dont elles sont la manifestation réelle.
Cela signifie que la manifestation des essences est d'abord une limitation de ces dernières en des portions observables (durée, taille, couleurs, formes, etc). Le principe manifestant est donc tout à la fois formant et limitant.
J’appelle l'ensemble de ce second principe, le principe matriciel. Et il n’apparaît pas nécessaire d'invoquer un quelconque troisième principe pour expliquer les phénomènes de la réalité. Cette dernière est la manifestation limitée dans le temps et l’espace du principe essentiel par le principe matriciel.
Et cela est nécessaire, car une absence de limites de cet ordre empêcherait une quelconque observation et donc l'expérience même de la réalité.
Remarquons tout de même que la manifestation permise par le principe matriciel ne se produit qu’à la condition de la destruction (inscription limitée dans un espace-temps avec un début et une fin de chaque forme). C’est un mécanisme universel qui suggère que le principe matriciel est à la fois manifestant et consommateur, là où le principe essentiel est informant, on pourrait dire « architectant ».
J’emploi des termes dynamiques car ces deux principes sont bien actifs tous deux et si je devais leur donner une intention primordiale (un égo, en quelque sorte, et j’y reviendrai plus tard), je dirais que le principe essentiel cherche à se manifester à travers le principe matriciel tandis que le principe matriciel cherche à consommer le principe essentiel en le manifestant tout d’abord. La manifestation apparaît donc ici comme une action conjointe et nécessaire à la réalisation des deux principes et il est aussi assez évident que le potentiel de ces deux principes est infini et donc que leurs intentions se renouvellent à l’infini : le principe essentiel peut continuellement chercher à se manifester à travers le principe matriciel et le principe matriciel peut continuellement chercher à consommer le principe essentiel.
Ces deux principes sont donc les deux éléments fondamentaux de la réalité, qui est donc duale. Ce sont aussi ces deux fondements qui donneront à chaque élément de la réalité une dimension intérieure occultée (l'essence) et une dimension extérieure tangible (la manifestation).
Mais n'oublions pas : tous les éléments identifiables de la réalité possèdent au moins un point commun. Ces deux principes primordiaux ne sont donc pas deux pôles isolés mais plutôt deux tendances très typiques non dénuées d'espaces d'interpénétration. À titre d'exemple, on pourrait poser ces questions : s'il est univoque, le principe matriciel n'a-t-il donc pas une essence matricielle ? Ou bien : si nous avons pu circonscrire l'existence du principe essentiel, cela ne signifie-t-il pas qu'il possède une forme et donc une matrice originelle ?
À ce titre, la représentation classique de la symbolique taoïste du yin et du yang est assez satisfaisante.
Aussi, dans un article précédent, j’expliquais que l’observation d’un phénomène qui n’est pas soi suppose l’existence de points communs et non communs entre soi et l’objet observé. Il demeure néanmoins tout à fait possible que ce qui est observé de cet objet soit incomplet. Pour l’exprimer d’une nouvelle manière, à partir des concepts développés dans le présent article : l’être expérimentant peut expérimenter des formes (objets et phénomènes) dont il partage les essences sous-jacentes mais ne peut pas expérimenter les manifestations qui dépendent d’essences qui lui sont complètement étrangères. En cela, un même objet peut nous apparaître de façon incomplète chaque fois que ce dernier possède des dimensions manifestées à partir d’essences qui ne sont pas à l’origine de notre propre forme en tant qu’êtres sensibles au monde.
Sur ce point, il convient de garder en mémoire que nous ne sommes pas égaux et que certains d’entre nous peuvent tout à fait observer des phénomènes que d’autres n’observent pas.
Dans un prochain article, j’expliquerai pourquoi il est judicieux de considérer le principe essentiel comme exclusif au masculin et le principe matriciel comme partagé entre le masculin et le féminin, et comment cela permet de comprendre aisément les comportements humains.