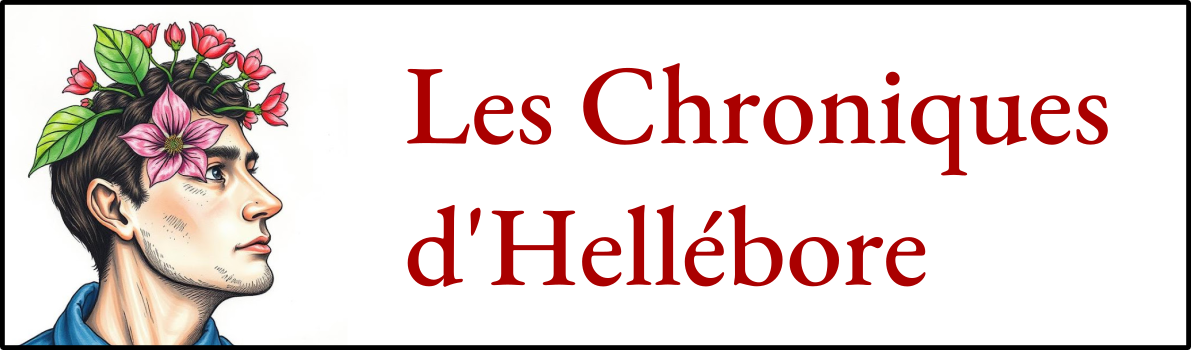La dualité expérientielle


Développons ici ce qui doit être entendu comme le principe d’expérience, condition nécessaire à toute pensée, a fortiori philosophique.
L’expérimentateur que je suis présente une dualité indissociable : je suis sensible au monde et j’influence le monde. Cette dualité est valable pour tous les objets qu’il est possible de considérer.
Lorsque je lance un caillou dans une mare, le caillou est à la fois récepteur de la poussée que je lui applique et transmetteur de cette poussée : il est à la fois sensible au monde et influe dans ce monde. S’il n’était que sensible, il absorberait tout et s’il n’était qu’influent, aucune de ses caractéristiques ne serait altérable.
La sensibilité peut être comprise comme une disposition passive de l’être tandis que l’influence est active. Cette dualité est au cœur du principe de causalité, où les objets interviennent comme des relais des influences du monde.
L’influence au monde est plus ou moins élaborée selon les objets. En ce qui concerne l’être humain, cette influence s’élabore de différentes façons :
par notre propre existence formelle, à des degrés que nous ne sommes manifestement pas à même d’embrasser simultanément en totalité
par notre capacité d’interprétation des stimuli du monde (nos sens, dont la teneur précise peut être discutée)
par notre psyché (inconscient et conscient dont fait partie la pensée, construits à partir de notre interprétation du monde)
La philosophie ici est donc une minuscule partie de notre capacité d’influence sur le monde et elle s’élabore notamment à partir de notre capacité à interpréter notre environnement.
Il convient cependant de préciser ici que dès lors que l’on entre dans le champ de l’interprétation, nous entrons du même coup dans celui du risque d’erreur. En effet, il est fréquent dans nos vies d’interpréter de façon erronée ce que nous voyons, entendons ou sentons. Ici, ce n’est pas la source stimulante qui est erronée, elle ne saurait l’être puisque ce n’est pas dans le fait d’être observé que peut se glisser une erreur mais justement dans le fait d’observer.
Ces erreurs ont toujours la même cause : une conclusion hâtive de notre psyché (c’est notamment le cas des réflexes de peur, déclenchés parfois de façon irrationnelle, simplement parce que notre cerveau a confondu la situation présente avec une situation qu’il a identifié comme comportant un risque).
Précisons également que l’ampleur de la sensibilité d’un être va avoir un impact direct sur l’ampleur de la diversité de ce qu’il pourra interpréter. Ici, il ne s’agit pas à proprement parler d’erreur mais simplement de limitation. L’erreur serait de considérer ses propres limites comme des limites absolues mais cela est bien une erreur de conclusion hâtive et non un problème lié à une sensibilité partielle.
Ajoutons aussi que notre influence au monde nous concerne également nous-mêmes dans ce monde. Ainsi, je suis moi-même réceptif à ma propre influence et peut donc changer un tant soit peu de nature en fonction de l’influence que j’exerce sur moi-même. Ce bouclage de sensibilité et d’influence sur soi-même ne peut être parfaitement compris par le principal intéressé, tout simplement parce que sa capacité à le comprendre en est justement altérée à tout instant, y compris dans la possibilité de faire appel à sa mémoire, qui ne serait qu’une réinterprétation a posteriori et donc hors contexte.
Rendus là de nos réflexions, une question philosophique épineuse se pose souvent, à savoir : à quel degré mon interprétation du monde influe-t-elle sur la perception que j’en ai ? En d’autres termes, sommes-nous véritablement sûrs que ce que nous observons du monde en toute sincérité n’est pas déjà le fruit d’une interprétation inconsciente de notre part de quelque chose d’autre ?
Cette question implique la notion de nature authentique des objets de la réalité. En effet, en épurant notre pensée de ses scories (conclusions hâtives), qu’obtenons-nous en définitive ? À quoi ressemble réellement le monde ?
Il existe deux courants de pensée principaux dans ce domaine : ceux qui pensent que toutes les formes sont la résultante d’une interprétation de notre esprit et ceux qui considèrent l’humain comme étant un objet du monde, observant imparfaitement ce même monde, qui possède ainsi une réalité objective théorique.
Je proposerai ici une façon de concilier ces deux approches car je pense en effet qu’elles ne se contredisent que de façon apparente.
En abordant le sujet de façon schématique globale, nous pouvons poser les choses de cette façon : le monde est une combinaison d’un grand principe émetteur et d’un grand principe récepteur. Pris isolément, ces principes ne peuvent produire aucune forme tangible. En effet, le principe émetteur seul n’aurait nulle part où se projeter et le principe récepteur seul n’aurait rien à recevoir.
Ce qui distingue les deux approches usuelles précédemment citées est en fait une différence de contexte. La première approche considère la notion d’esprit dans un contexte global et la seconde dans un contexte humain. On pourrait dire que la seconde est en réalité contenue dans la première sans cependant la contredire. Il s’agit simplement d’un contexte différent vis-à-vis duquel l’application de la notion d’interprétation ne prend pas le même sens (interprétation de l’humain dans l’univers, interprétation de l’univers sur lui-même).
Cela signifie que toutes les recherches touchant à ce sujet de l’interprétation dans notre observation du monde, c’est-à-dire de la dimension active de l’observateur (décodage), doivent nécessairement préciser quel est leur contexte d’ancrage (comme toutes les recherches d’ailleurs).
La question suivante qui se pose naturellement est donc en réalité la définition de l’humanité. Je reviendrai sur ce point dans un article ultérieur.