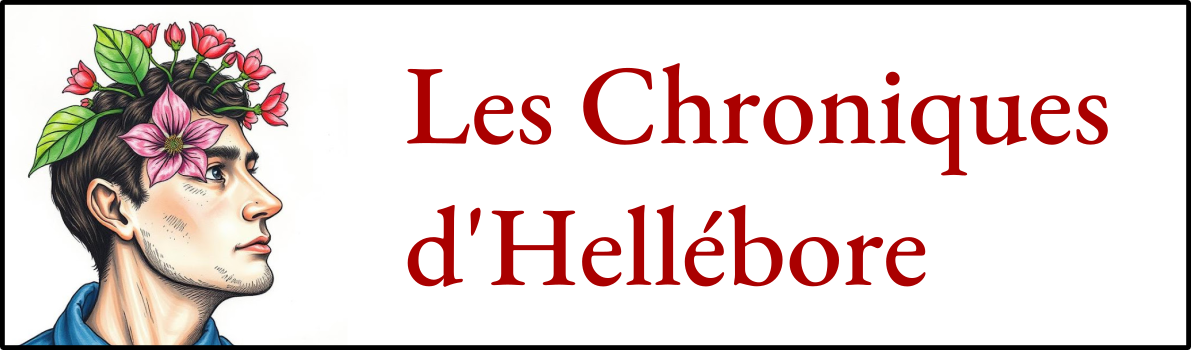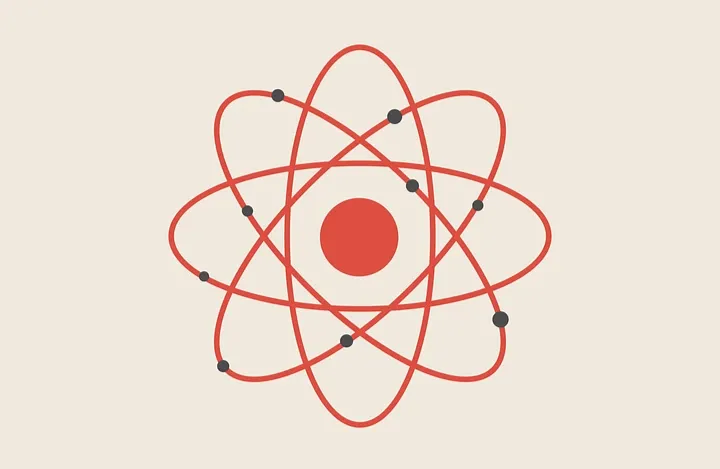Distribution du pouvoir : confiance, méfiance et impuissance


Dans un des mes articles précédents, j’ai rapidement évoqué la notion d’impuissance. Je propose dans cet article de replacer ce concept dans le cadre qui lui convient, à savoir le rapport au pouvoir.
Le pouvoir, c’est la capacité de contrôle sur le monde. Le fait que je puisse faire pousser des plantes qui m’intéressent et tuer des plantes qui me dérangent, comme le fait tout jardinier, c’est une expression d’un pouvoir sur mon environnement.
Donner la vie, la prendre ou la modifier, c’est ainsi que s’exprime le pouvoir et, en l’occurrence, l’être humain semble disposer d’un pouvoir assez énorme sur le monde, comparativement aux autres espèces animales.
Individuellement, c’est cependant une autre affaire. Chacun d’entre nous sait ou sent peu ou prou quels sont les espaces où son pouvoir va pouvoir s’exercer et ceux où il ne va pas pouvoir s’exercer. Nous pouvons par exemple avoir un certain pouvoir sur les vêtements que nous allons porter mais nous n’allons cependant pas toujours pouvoir choisir n’importe quel vêtement, car cela va dépendre aussi de notre capacité à obtenir ce dernier, et notamment de notre pouvoir d’achat.
Dans notre existence, nous sommes en interaction avec d’autres individus pour former des groupes. En cela, nous sommes capables dans une certaine mesure (selon la qualité de nos interprétations) de reconnaître les espaces où l’exercice :
de notre propre pouvoir nous sera profitable
de notre propre pouvoir ne nous sera pas profitable
du pouvoir de certaines personnes nous sera profitable
du pouvoir de certaines personnes ne nous sera profitable
C’est à travers ces différentes estimations que nous allons nourrir de la confiance, de la méfiance et développer un certain sens des responsabilités.
Nous placerons la confiance en nous-mêmes et en autrui de la façon qui nous paraîtra la plus bénéfique dans notre balance transactionnelle. Cela ne veut pas dire que nous allons toujours avoir raison sur ce point, nous faisons ces choix en fonction de ce qui nous semble juste (à l’aune de nos interprétations, qu’elles fussent conscientes ou non).
Habituellement, nous ne réservons notre confiance que dans les contextes où nous estimons disposer de suffisamment d’informations pour prendre une « décision de confiance ». Spontanément, la quasi totalité des êtres vivants se méfient des autres êtres qu’ils ne connaissent pas, car ils ne savent pas bien qui ils sont, quelles sont leurs intentions mais aussi leurs compétences.
La méfiance se construit donc en opposition de la confiance et cela peut tout à fait concerner les mêmes personnes, y compris nous-mêmes : nous pouvons par exemple faire confiance à quelqu’un pour construire notre maison mais pas pour garder nos enfants.
La raison pour laquelle ces questions sont importantes est loin d’être anodine. En effet, donner sa confiance à quelqu’un, c’est accepter de perdre du contrôle sur l’espace concerné par cette confiance. Cependant, dans bien des cas, cette perte de contrôle n’est pas totale car nous conservons un certain contrôle sur la relation en elle-même. D’ailleurs, lorsque nous sentons que nous perdons du contrôle sur une relation, il arrive que nous perdions aussi notre confiance car alors, nous perdons littéralement notre pouvoir sur la situation. Ce mécanisme n’est cependant pas systématique car il peut arriver que nous placions une confiance sans condition, aveugle, en certaines personnes, pour peu que nous ayons reconnu chez elles une identité qui nous est intrinsèquement bonne et que nous identifions la perte totale de contrôle comme profitable. On peut, par exemple, penser à la confiance que la plupart des enfants ont en leurs parents ou la confiance que nous avons en un chirurgien qui s’apprête à pratiquer sur nous une opération à cœur ouvert.
Dans un contexte de couple, par exemple, on peut se reposer sur son conjoint pour certaines tâches ou certaines décisions parce que nous estimons qu’il est mieux placé que nous-mêmes pour ce faire, mais nous n’abandonnons pas pour autant notre pouvoir de décision au sein même du couple. Il s’agit en l’occurrence d’une forme seulement partielle d’abandon à l’autre et si cela est particulièrement sensible pour nous, c’est parce que nous savons que nos interprétations peuvent parfois être fausses. C’est d’ailleurs ici que peut prendre source la déception, c’est-à-dire une confiance non honorée qui était en partie basée sur l’espoir (un bénéfice incertain).
Cette manière de distribuer le pouvoir, en prenant pour nous certaines choses et en redonnant à d’autres certaines autres choses, cristallise en nous notre vision des responsabilités de tout un chacun. Nous nous sentirons responsables de certaines choses quand nous tiendrons responsables de certaines autres choses d’autres personnes. C’est d’ailleurs un avantage subséquent très important à considérer dans les dynamiques sociales, à savoir que de donner du pouvoir à autrui nous arrange d’abord en termes de compétences mais peut aussi nous arranger en termes de responsabilités. Car être responsable de quelque chose, c’est s’exposer à de possibles mauvais traitements s’il s’avère que nous décevons par trop les personnes qui nous ont laissé la responsabilité en question. Il est donc confortable pour de nombreuses personnes de laisser le pouvoir à d’autres dans la mesure où cela les absout de toute responsabilité dans son exercice.
Cet abandon de certains espaces de pouvoir peut même aller jusqu’à laisser à autrui le soin de décider pour soi justement à ce propos. Laisser autrui décider ce que l’on doit ou non lui donner comme pouvoir peut ressembler à une forme de folie mais c’est un phénomène bien réel dans toutes les sociétés et plus cet abandon est grand, plus la structure de pouvoir qui se met en place est celle du parent et de l’enfant, que l’on pourrait aussi qualifier parfois du maître et de l’esclave, lorsque cette structure devient tyrannique. Bien sûr, la diversité humaine empêche toute forme d’univocité des schémas et c’est assez heureux car dans le cas contraire, toute structuration de pouvoir deviendrait définitive.
Je reviendrai dans mon article suivant plus précisément sur les caractères humains sociaux et leurs dynamiques relationnelles.
Il existe aussi des espaces sur lesquels nous n’avons pas de contrôle mais souhaitons en avoir. Ici, nous pouvons endosser le rôle de conquérir ce pouvoir ou bien de déléguer cette conquête à quelqu’un d’autre sur qui nous avons un certain contrôle (situation relationnelle).
Cela provient de l’idée que de contrôler ces espaces nous sera plus profitable que de le laisser sous contrôle d’autre chose et notamment de quelqu’un d’autre sur qui nous n’avons aucun contrôle.
Nous nous reconnaissons préalablement impuissants vis-à-vis de ces espaces mais nous gageons que cela n’est pas une fatalité et que nous pouvons y remédier. Il existe aussi des espaces de contrôle que nous reconnaissons inaccessibles et pour ceux-là, on peut dire que nous nous en remettons à Dieu.
Dans le premier cas, si les espaces de pouvoir que nous convoitons sont déjà occupés par des personnes qui ne souhaitent pas perdre ce pouvoir, un conflit éclatera. C’est le cas dans les couples par exemple où, lorsque les deux conjoints convoitent les mêmes espaces de pouvoir, des querelles éclatent.
En termes d’identification des espaces de confiance, de méfiance et d’impuissance, tout est possible au sein de l’être humain. Certaines personnes ne font confiance à personne, d’autres font confiance à tout le monde, certaines personnes se sentent responsables de tout, d’autres de rien, certaines personnes pensent pouvoir exercer un contrôle sur toutes les choses, d’autres sur rien du tout, certaines veulent tout contrôler sans en porter la responsabilité (cas typique des femmes), d’autres encore veulent profiter des émoluments de la responsabilité sans exercer de pouvoir, etc.
Toutes ces approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il convient cependant de dire qu’en termes de survie et de développement d’une puissance collective, un minimum de confiance en autrui est indispensable dès lors que l’on souhaite fonctionner à plus d’une personne, ce qui est obligatoire pour les animaux sociaux. Cette confiance ne sera d’ailleurs permise qu’à la condition d’une capacité de prise de pouvoir en retour. En effet, lorsque l’on donne à autrui l’autorisation d’exercer son pouvoir à notre place dans telle ou telle circonstance, cela ne fait sens que si autrui l’exerce bel et bien car, dans le cas contraire, l’espace de pouvoir en question ne serait pas comblé et une crise surviendrait, notamment parce qu’il n’existe manifestement pas d’espaces sans contrôle dans la nature et que cela reviendrait donc à laisser à une force exogène (connue ou inconnue) le soin de décider pour nous, ce qui serait alors très propice à la peur. Dans les faits sociaux, il est fréquent que ces moments de fragilisation d’un exercice de pouvoir donne lieu à une rivalité dans la revendication de ce dernier.
En ce qui concerne les couples, deux caractères ayant propension à dominer (c’est-à-dire à exercer eux-mêmes le pouvoir plutôt que de le déléguer) se fréquentant auront tendance à la confrontation et ce d’autant plus souvent et fortement que les deux profils seront dominants. Deux profils plutôt soumis auront tendance à entrer en crise d’une autre manière en se laissant tout simplement dominer par des éléments exogènes qui auront tendance à briser le couple. Les couples qui, en revanche, sont solides et n’entrent pas ou peu en conflit sont des couples où les deux protagonistes exercent leur pouvoir précisément là où l’autre leur laisse le pouvoir. Cela ne présage pas du degré de dominance ou de soumission de l’un et de l’autre, simplement du fait que les deux profils sont très compatibles.
Cela ne présage pas non plus du degré de puissance d’une personne qui se définit par l’ampleur de l’expression de sa nature. Une personne soumise peut être puissante si sa soumission trouve un équilibre dans l’expression d’une grande domination. Une personne puissante et soumise ne trouverait pas son content auprès d’une personne dominante mais faible, elle aurait besoin de trouver ailleurs davantage de domination. Cette confusion est très fréquente du fait que l’attitude dominatrice est confondue avec la puissance, or, il n’en est rien, et la nature nous le montre tous les jours : le caractère dominateur ou soumis s’exprime à tous les niveaux de puissance et la particularité des êtres à la fois dominants et faibles est de régulièrement s’exposer à la défaite ou à la mort en rencontrant des êtres dominants plus puissants. C’est aussi ce qui explique parfois que certaines personnes soumises quittent malgré tout leur conjoint dominateur. Dans bien des cas, ce n’est pas l’attitude dominatrice du conjoint qui est en cause mais le fait que ce dernier ait une identité ou une puissance incompatibles avec les besoins de l’autre, et notamment une puissance trop faible.
Dans notre culture actuelle, en Occident, les notions de domination et de soumission sont souvent perçues comme négatives car nous faisons le plus souvent l’apologie de l’individu parfaitement autonome et accompli par lui-même, une obsession possiblement héritée de Carl Gustav Jung et des philosophies orientales. Cette approche est cependant complètement fantaisiste dans notre réalité car elle ne représente aucune réalité personnelle observable et ne permet aucun fonctionnement social. Tout au mieux cela pourrait montrer une ressemblance avec l’archétype du caractère autonome qui est, comme nous allons le voir dans le prochain article, une expression particulière de l’être humain qui n’a rien de plus valable que les autres mais fait simplement partie d’un tout.
Il est au contraire tout à fait normal d’avoir en nous des espaces de domination et d’autres de soumission. Si cela peut poser parfois des problèmes personnels, de couples ou de civilisations, il ne faut pas en chercher la source dans ces principes mêmes mais dans leurs expressions et éventuels déséquilibres contextuels.