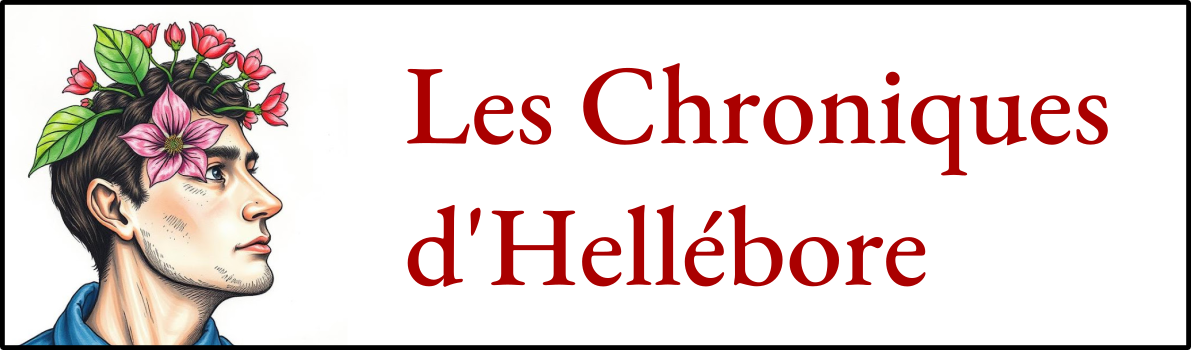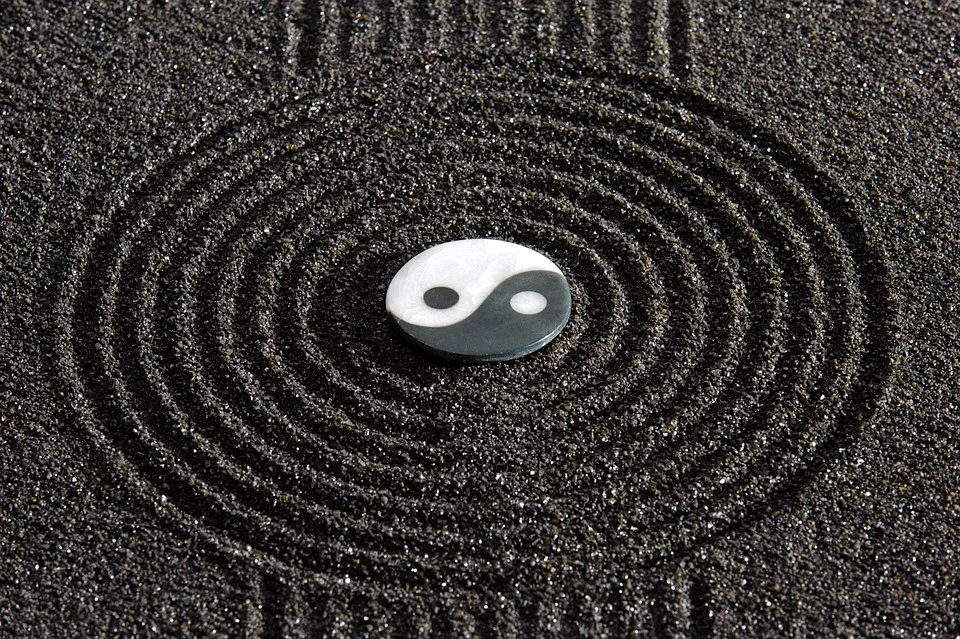Définition de Dieu


Le terme de Dieu est un terme suremployé dans nos sociétés et il est assez simple de constater qu’il recouvre généralement de nombreuses réalités différentes selon l’idée que s’en formule celui ou celle qui l’emploie.
Dans le cadre de la pensée que je développe, Dieu a un sens précis. Il est l’unité absolue de toutes les choses et de toutes les non-choses. Il est l’ensemble de ce qui est et n’est pas, peut être et ne peut pas être, a été, est et sera. Il est la réunion de tous les contraires, de tous les points communs et des points non communs, de tout ce qui est de l’expérience et ce qui est en dehors. Il est l’origine, la vie et la fin de toute chose.
Dieu est donc un terme d’absolu, de totalité et dont la praticité se justifie dans cet usage seulement en ce qui concerne mon propos. En termes théologiques, on appelle cette vision de la divinité un panenthéisme (et non un panthéisme) dans le sens où Dieu ne se résume pas à la matérialité du monde, qui n’est que sa forme manifestée, c’est-à-dire l’une de ses dimensions seulement. Il est donc bien plus vaste que la réalité accessible à l’expérience.
Par ailleurs, puisque Dieu intègre toutes les choses, le terme peut donc être employé chaque fois que l’on bute contre une incertitude. Par exemple :
« Cette trahison aura-t-elle des conséquences fâcheuses ? Seul Dieu le sait. »
C’est une façon d’expliquer que la réponse existe mais que je ne l’ai pas. Cela peut même vouloir dire, dans certains contextes, que je ne peux pas la connaître.
Autre exemple, lorsque l’on dit « Je m’en remets à Dieu », nous entendons par là que nous abandonnons l’idée de contrôler notre destin et que nous acceptons les choses telles qu’elles viennent et viendront.
Cependant, Dieu ne devrait pas être un fourre-tout. En effet, comme nous l’avons vu et comme il est évident que nous le constatons dans le domaine des sciences, la réalité présente des principes, des lois, des règles. Parmi elles notamment : le principe de coexistence, le principe de relation et le principe d’éphémérité (ce qui prend forme ne dure pas éternellement), que nous avons vu dans les articles précédents.
Par ailleurs, bien qu’elles refusent d’employer le terme, les personnes athées usent très souvent d’une idée de Dieu. Lorsqu’un scientifique athée appuie son travail sur la notion d’une vérité unique, par exemple, il tient compte en réalité de Dieu. Il intègre dans son paradigme de travail le fait qu’il existe une unité de réalité dans notre expérience du monde, il ne l’appelle pas Dieu mais c’est tout comme.
Aussi, lorsque des personnes athées s’en réfèrent au hasard pour expliquer un phénomène, cela revient dans certains cas à la même chose que de s’en référer à Dieu puisqu’il peut s’agir en l’occurrence d’admettre une limite à la compréhension d’un phénomène (nommer hasard les déterminismes que nous ne comprenons pas). On peut tout de même envisager qu’il existe des phénomènes réellement aléatoires mais il semble impossible de le prouver définitivement puisque nos connaissances évoluent sans cesse.
De même, se référer à la nature comme un concept unitaire cohérent, c’est intégrer implicitement l’idée de Dieu à son propos.
Ce qui dissuade de nombreuses personnes d’employer le terme de Dieu est en fait, non pas la définition même que l’on peut en donner et qui ne devrait pas à mon sens, être autre chose que ce que je viens de présenter, mais l’héritage de violence et de superstitions qui provient du vocable même et qui, en périodes d’incertitudes spirituelles, resurgit à toutes les sauces pour servir des desseins qu’il est aisé de considérer comme malveillants.
Parmi les exagérations les plus claires sur le sujet, on trouve l’idée que ne pas suivre certains préceptes (plus ou moins artificiels) est par essence une mauvaise chose et réclame donc une rectification, y compris lorsque les contrevenants sont extérieurs à la société qui prône ces attitudes (j’aurais l’occasion d’y revenir de nombreuses fois dans d’autres articles traitant plus précisément des phénomènes de groupe et des religions monothéistes).
Une autre interprétation malheureuse de l’idée de Dieu est la hiérarchisation entre la réalité formée et le principe essentiel, qui en est sous-jacent, l’idée que certaines choses sont de l’ordre du sacré et d’autres de l’ordre du profane. En d’autres termes, la nature serait par essence inférieure à Dieu. Cette interprétation est erronée pour deux raisons :
- puisque Dieu est toutes les choses, alors la nature est aussi Dieu et la dénigrer revient à dénigrer Dieu
- concevoir l’idée que la nature est une version imparfaite de Dieu est en fait une confusion entre Dieu et le principe essentiel, qui n’est qu’un des deux éléments de base de la réalité, mais n’est pas Dieu, seulement l’un de ses enfants, pourrait-on dire
Cette confusion est très importante à comprendre, car elle est à la racine de nombreux égarements théologiques de ces derniers millénaires, et pas seulement au sein des religions monothéistes.
Dieu n’est ni masculin, ni féminin et aussi les deux à la fois. Nous verrons plus tard qu’il est correct de considérer que le principe essentiel est un principe absolument masculin. En cela, nous pouvons l’appeler Dieu le Père, ce serait assez juste, mais Dieu le Père n’est pas Dieu. Le principe matriciel quant à lui, mériterait le nom de Déesse Mère, c’est tout aussi correct, mais il n’est pas Dieu non plus (1).
L’effacement dans certaines religions de la Déesse Mère au profit d’un Dieu le Père qui régnerait seul sur la réalité est une erreur théologique fondamentale qui ne peut que produire des apories philosophiques.
Les attributs qu’on lui donne traditionnellement, comme le fait ne pas être directement accessible dans la matière ou le fait d’être à l’origine de lois indépassables sont corrects, mais ne s’en référer qu’à lui seul n’est pas suffisant car, seul, Dieu le Père ne peut pas se manifester et il ne peut donc pas créer la réalité naturelle.
Bien évidemment, l’usage de ces notions à travers l’Histoire s’expliquent davantage par des projets de domination des groupes humains que par une application sincère à la vérité. Il est notamment plus efficace pour maintenir une communauté sous contrôle par la peur de présenter Dieu comme un père distant, invisible, omniscient, omniprésent, omnipotent et exigent (voire tyrannique et violent). Mais c’est en fait une dégradation de la connaissance de la réalité, une vision tantôt partielle, tantôt exagérée et tantôt fausse, un bricolage stratégique plus qu’une œuvre de connaissance.
Rappelons-nous néanmoins que ces égarements théologiques sont récents dans l’histoire humaine, quatre mille ans tout au plus dans certaines régions du globe. C’est très peu, si l’on tient compte du fait que les premières traces de rituels à connotation religieuse retrouvées jusqu’à présent datent de près de 175 000 ans (Bruniquel, en France, peuplement néandertalien).
Rejeter l’idée de Dieu et son vocable même revient donc à les laisser tous deux à des groupes qui en expriment une idée particulièrement déformée et asymétrique, qui ne peut être satisfaisante d’un point de vue rigoureusement philosophique et qui, de surcroît, est particulièrement récente dans l’histoire de l’humanité. Se refuser à considérer le sujet, c’est, à mon sens, entériner la confiscation de l’idée de Dieu et le terme qui lui est traditionnellement adjoint.
Pour ma part, au contraire, je prétends à le réemployer au travers de définitions les plus exactes possibles et je gage d’ailleurs que bien des énervements seraient évités si tout un chacun s’employait à cette discipline. Combien de fois peut-on observer sur Internet des discussions enragées entre personnes athées et religieuses alors même qu’elles parlent de la même chose, simplement, en n’employant pas les mêmes termes ?
Pour finir, je rappelle que si Dieu est un concept que nous usons dans nos discussions, il se réfère bien entendu à une réalité, comme tous les concepts un tant soit peu pertinents. Il ne s’agit donc pas davantage d’une facilité dialectique que de la traduction imparfaite d’un réel certain.
(1) Il ne faudrait pas commettre l’erreur de penser ici la notion de paternité et de maternité dans leur sens usuel restreint, il s’agit ici des aspects masculins et féminins dans toute leur complétude. En cela, on peut voir en l’homme le père, l’époux, l’amant, le fils, le frère ou autre et en la femme la mère, l’épouse, l’amante, la fille, la sœur ou autre.⮥